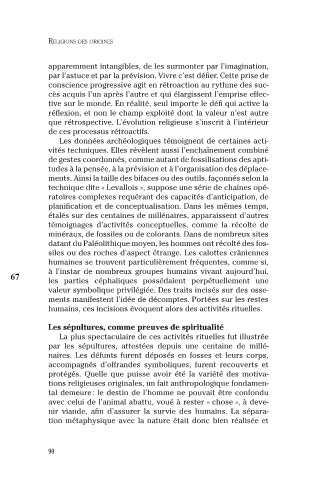Page 68 - Revue 3 A
P. 68
Religions des oRigines
apparemment intangibles, de les surmonter par l’imagination,
par l’astuce et par la prévision. Vivre c’est défier. Cette prise de
conscience progressive agit en rétroaction au rythme des suc-
cès acquis l’un après l’autre et qui élargissent l’emprise effec-
tive sur le monde. En réalité, seul importe le défi qui active la
réflexion, et non le champ exploité dont la valeur n’est autre
que rétrospective. L’évolution religieuse s’inscrit à l’intérieur
de ces processus rétroactifs.
Les données archéologiques témoignent de certaines acti-
vités techniques. Elles révèlent aussi l’enchaînement combiné
de gestes coordonnés, comme autant de fossilisations des apti-
tudes à la pensée, à la prévision et à l’organisation des déplace-
ments. Ainsi la taille des bifaces ou des outils, façonnés selon la
technique dite « Levallois », suppose une série de chaînes opé-
ratoires complexes requérant des capacités d’anticipation, de
planification et de conceptualisation. Dans les mêmes temps,
étalés sur des centaines de millénaires, apparaissent d’autres
témoignages d’activités conceptuelles, comme la récolte de
minéraux, de fossiles ou de colorants. Dans de nombreux sites
datant du Paléolithique moyen, les hommes ont récolté des fos-
siles ou des roches d’aspect étrange. Les calottes crâniennes
humaines se trouvent particulièrement fréquentes, comme si,
à l’instar de nombreux groupes humains vivant aujourd’hui,
67 les parties céphaliques possédaient perpétuellement une
valeur symbolique privilégiée. Des traits incisés sur des osse-
ments manifestent l’idée de décomptes. Portées sur les restes
humains, ces incisions évoquent alors des activités rituelles.
Les sépultures, comme preuves de spiritualité
La plus spectaculaire de ces activités rituelles fut illustrée
par les sépultures, attestées depuis une centaine de millé-
naires. Les défunts furent déposés en fosses et leurs corps,
accompagnés d’offrandes symboliques, furent recouverts et
protégés. Quelle que puisse avoir été la variété des motiva-
tions religieuses originales, un fait anthropologique fondamen-
tal demeure : le destin de l’homme ne pouvait être confondu
avec celui de l’animal abattu, voué à rester « chose », à deve-
nir viande, afin d’assurer la survie des humains. La sépara-
tion métaphysique avec la nature était donc bien réalisée et
90