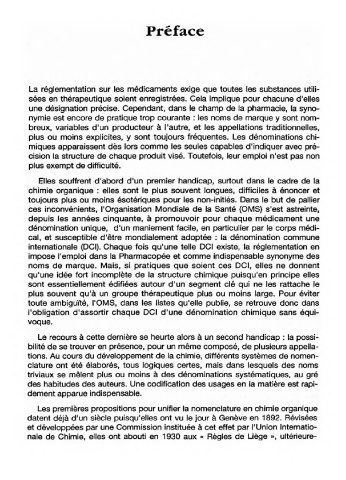Page 58 - Traité de Chimie Thérapeutique Vol1 Dénomination chimique
P. 58
Préface
La réglementation sur les médicaments exige que toutes les substances utili
sées en thérapeutique soient enregistrées. Cela implique pour chacune d'elles
une désignation précise. Cependant, dans le champ de la pharmacie, la syno
nymie est encore de pratique trop courante : les noms de marque y sont nom
breux, variables d'un producteur à l'autre, et les appellations traditionnelles,
plus ou moins explicites, y sont toujours fréquentes. Les dénominations chi
miques apparaissent dès lors comme les seules capables d'indiquer avec pré
cision la structure de chaque produit visé. Toutefois, leur emploi n'est pas non
plus exempt de difficulté.
Elles souffrent d'abord d'un premier handicap, surtout dans le cadre de la
chimie organique : elles sont le plus souvent longues, difficiles à énoncer et
toujours plus ou moins ésotériques pour les non-initiés. Dans le but de pallier
ces inconvénients, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s'est astreinte,
depuis les années cinquante, à promouvoir pour chaque médicament une
dénomination unique, d'un maniement facile, en particulier par le corps médi
cal, et susceptible d'être mondialement adoptée : la dénomination commune
internationale (DCI). Chaque fois qu'une telle DCI existe, la réglementation en
impose l'emploi dans la Pharmacopée et comme indispensable synonyme des
noms de marque. Mais, si pratiques que soient ces DCI, elles ne donnent
qu'une idée fort incomplète de la structure chimique puisqu'en principe elles
sont essentiellement édifiées autour d'un segment clé qui ne les rattache le
plus souvent qu'à un groupe thérapeutique plus ou moins large. Pour éviter
toute ambiguïté, l'OMS, dans les listes qu'elle publie, se retrouve donc dans
l'obligation d'assortir chaque DCI d'une dénomination chimique sans équi
voque.
Le recours à cette dernière se heurte alors à un second handicap : la possi
bilité de se trouver en présence, pour un même composé, de plusieurs appella
tions. Au cours du développement de la chimie, différents systèmes de nomen
clature ont été élaborés, tous logiques certes, mais dans lesquels des noms
triviaux se mêlent plus ou moins à des dénominations systématiques, au gré
des habitudes des auteurs. Une codification des usages en la matière est rapi
dement apparue indispensable.
Les premières propositions pour unifier la nomenclature en chimie organique
datent déjà d'un siècle puisqu'elles ont vu le jour à Genève en 1892. Révisées
et développées par une Commission instituée à cet effet par l’Union Internatio
nale de Chimie, elles ont abouti en 1930 aux « Règles de Liège », ultérieure-