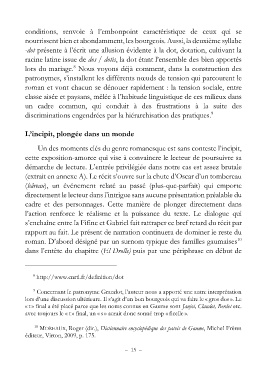Page 15 - Travail L'Oscar èt l'Alfred-etude-de-Louis-Mores
P. 15
conditions, renvoie à l’embonpoint caractéristique de ceux qui se
nourrissent bien et abondamment, les bourgeois. Aussi, la deuxième syllabe
-dot présente à l’écrit une allusion évidente à la dot, dotation, cultivant la
racine latine issue de dos / dotis, la dot étant l’ensemble des bien apportés
8
lors du mariage. Nous voyons déjà comment, dans la construction des
patronymes, s’installent les différents nœuds de tension qui parcourent le
roman et vont chacun se dénouer rapidement : la tension sociale, entre
classe aisée et paysans, mêlée à l’habitude linguistique de ces milieux dans
un cadre commun, qui conduit à des frustrations à la suite des
discriminations engendrées par la hiérarchisation des pratiques. 9
L’incipit, plongée dans un monde
Un des moments clés du genre romanesque est sans conteste l’incipit,
cette exposition-amorce qui vise à convaincre le lecteur de poursuivre sa
démarche de lecture. L’entrée privilégiée dans notre cas est assez brutale
(extrait en annexe A). Le récit s’ouvre sur la chute d’Oscar d’un tombereau
(bâreau), un événement relaté au passé (plus-que-parfait) qui emporte
directement le lecteur dans l’intrigue sans aucune présentation préalable du
cadre et des personnages. Cette manière de plonger directement dans
l’action renforce le réalisme et la puissance du texte. Le dialogue qui
s’enchaîne entre la Fifine et Gabriel fait rattraper ce bref retard du récit par
rapport au fait. Le présent de narration continuera de dominer le reste du
roman. D’abord désigné par un surnom typique des familles gaumaises 10
dans l’entête du chapitre (El Drolle) puis par une périphrase en début de
8
http://www.cnrtl.fr/definition/dot
9
Concernant le patronyme Graudot, l’auteur nous a apporté une autre interprétation
lors d’une discussion ultérieure. Il s’agit d’un bon bourgeois qui va faire le « gros dos ». Le
« t » final a été placé parce que les noms connus en Gaume sont Janjot, Claudot, Berdot etc.
avec toujours le « t » final, un « s » aurait donc sonné trop « ficelle ».
10
MOREAUX, Roger (dir.), Dictionnaire encyclopédique des patois de Gaume, Michel Frères
éditeur, Virton, 2009, p. 175.
– 15 –
nourrissent bien et abondamment, les bourgeois. Aussi, la deuxième syllabe
-dot présente à l’écrit une allusion évidente à la dot, dotation, cultivant la
racine latine issue de dos / dotis, la dot étant l’ensemble des bien apportés
8
lors du mariage. Nous voyons déjà comment, dans la construction des
patronymes, s’installent les différents nœuds de tension qui parcourent le
roman et vont chacun se dénouer rapidement : la tension sociale, entre
classe aisée et paysans, mêlée à l’habitude linguistique de ces milieux dans
un cadre commun, qui conduit à des frustrations à la suite des
discriminations engendrées par la hiérarchisation des pratiques. 9
L’incipit, plongée dans un monde
Un des moments clés du genre romanesque est sans conteste l’incipit,
cette exposition-amorce qui vise à convaincre le lecteur de poursuivre sa
démarche de lecture. L’entrée privilégiée dans notre cas est assez brutale
(extrait en annexe A). Le récit s’ouvre sur la chute d’Oscar d’un tombereau
(bâreau), un événement relaté au passé (plus-que-parfait) qui emporte
directement le lecteur dans l’intrigue sans aucune présentation préalable du
cadre et des personnages. Cette manière de plonger directement dans
l’action renforce le réalisme et la puissance du texte. Le dialogue qui
s’enchaîne entre la Fifine et Gabriel fait rattraper ce bref retard du récit par
rapport au fait. Le présent de narration continuera de dominer le reste du
roman. D’abord désigné par un surnom typique des familles gaumaises 10
dans l’entête du chapitre (El Drolle) puis par une périphrase en début de
8
http://www.cnrtl.fr/definition/dot
9
Concernant le patronyme Graudot, l’auteur nous a apporté une autre interprétation
lors d’une discussion ultérieure. Il s’agit d’un bon bourgeois qui va faire le « gros dos ». Le
« t » final a été placé parce que les noms connus en Gaume sont Janjot, Claudot, Berdot etc.
avec toujours le « t » final, un « s » aurait donc sonné trop « ficelle ».
10
MOREAUX, Roger (dir.), Dictionnaire encyclopédique des patois de Gaume, Michel Frères
éditeur, Virton, 2009, p. 175.
– 15 –