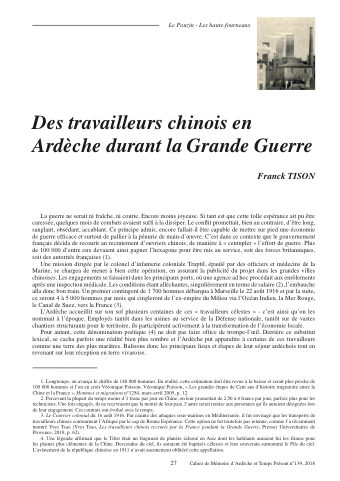Page 29 - matp
P. 29
Le Pouzin - Les hauts-fourneaux
Des travailleurs chinois en Ardèche durant la Grande Guerre
Franck TISON
La guerre ne serait ni fraîche, ni courte. Encore moins joyeuse. Si tant est que cette folle espérance ait pu être caressée, quelques mois de combats avaient suf à la dissiper. Le con it promettait, bien au contraire, d’être long, sanglant, obsédant, accablant. Ce principe admis, encore fallait-il être capable de mettre sur pied une économie de guerre ef cace et surtout de pallier à la pénurie de main-d’œuvre. C’est dans ce contexte que le gouvernement français décida de recourir au recrutement d’ouvriers chinois, de manière à « centupler » l’effort de guerre. Plus de 100 000 d’entre eux devaient ainsi gagner l’hexagone pour être mis au service, soit des forces britanniques, soit des autorités françaises (1).
Une mission dirigée par le colonel d’infanterie coloniale Truptil, épaulé par des of ciers et médecins de la Marine, se chargea de mener à bien cette opération, en assurant la publicité du projet dans les grandes villes chinoises. Les engagements se faisaient dans les principaux ports, où une agence ad hoc procédait aux enrôlements après une inspection médicale. Les conditions étant alléchantes, singulièrement en terme de salaire (2), l’embauche alla donc bon train. Un premier contingent de 1 700 hommes débarqua à Marseille le 22 août 1916 et par la suite, ce seront 4 à 5 000 hommes par mois qui cingleront de l’ex-empire du Milieu via l’Océan Indien, la Mer Rouge, le Canal de Suez, vers la France (3).
L’Ardèche accueillit sur son sol plusieurs centaines de ces « travailleurs célestes » - c’est ainsi qu’on les nommait à l’époque. Employés tantôt dans les usines au service de la Défense nationale, tantôt sur de vastes chantiers structurants pour le territoire, ils participèrent activement à la transformation de l’économie locale.
Pour autant, cette dénomination poétique (4) ne doit pas faire of ce de trompe-l’œil. Derrière ce substitut lexical, se cacha parfois une réalité bien plus sombre et l’Ardèche put apparaître à certains de ces travailleurs comme une terre des plus marâtres. Balisons donc les principaux lieux et étapes de leur séjour ardéchois tout en revenant sur leur réception en terre vivaroise.
1. Longtemps, on avança le chiffre de 140 000 hommes. En réalité, cette estimation doit être revue à la baisse et serait plus proche de 100 000 hommes si l’on en croit Véronique Poisson. Véronique Poisson, « Les grandes étapes de Cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la France », Hommes et migrations n°1254, mars-avril 2005, p. 12.
2. Percevant la plupart du temps moins d’1 franc par jour en Chine, on leur promettait de 2,50 à 4 francs par jour, parfois plus pour les techniciens. Une fois engagés, ils ne recevraient que la moitié de leur paie, l’autre serait remise aux personnes qu’ils auraient désignées lors de leur engagement. Ces contrats ont évolué avec le temps.
3. Le Courrier colonial du 16 août 1916. Par crainte des attaques sous-marines en Méditerranée, il fut envisagé que les transports de travailleurs chinois contournent l’Afrique par le cap de Bonne Espérance. Cette option ne fut toutefois pas retenue, comme l’a récemment montré Yves Tsao (Yves Tsao, Les travailleurs chinois recrutés par la France pendant la Grande Guerre, Presses Universitaires de Provence, 2018, p. 62).
4. Une légende af rmait que le Tibet était un fragment de planète échoué en Asie dont les habitants auraient fui les frimas pour les plaines plus clémentes de la Chine. Descendus du ciel, ils auraient été baptisés célestes et leur souverain surnommé le Fils du ciel. L’avènement de la république chinoise en 1911 n’avait aucunement oblitéré cette appellation.
27 Cahier de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent n°139, 2018