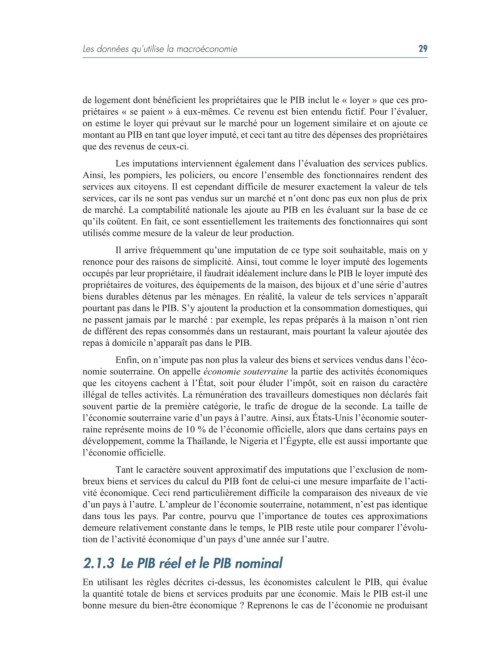Page 55 - C:\Users\Emmanuel CHITERA\Desktop\dan\
P. 55
Les données qu’utilise la macroéconomie 29
de logement dont bénéficient les propriétaires que le PIB inclut le « loyer » que ces pro-
priétaires « se paient » à eux-mêmes. Ce revenu est bien entendu fictif. Pour l’évaluer,
on estime le loyer qui prévaut sur le marché pour un logement similaire et on ajoute ce
montant au PIB en tant que loyer imputé, et ceci tant au titre des dépenses des propriétaires
que des revenus de ceux-ci.
Les imputations interviennent également dans l’évaluation des services publics.
Ainsi, les pompiers, les policiers, ou encore l’ensemble des fonctionnaires rendent des
services aux citoyens. Il est cependant difficile de mesurer exactement la valeur de tels
services, car ils ne sont pas vendus sur un marché et n’ont donc pas eux non plus de prix
de marché. La comptabilité nationale les ajoute au PIB en les évaluant sur la base de ce
qu’ils coûtent. En fait, ce sont essentiellement les traitements des fonctionnaires qui sont
utilisés comme mesure de la valeur de leur production.
Il arrive fréquemment qu’une imputation de ce type soit souhaitable, mais on y
renonce pour des raisons de simplicité. Ainsi, tout comme le loyer imputé des logements
occupés par leur propriétaire, il faudrait idéalement inclure dans le PIB le loyer imputé des
propriétaires de voitures, des équipements de la maison, des bijoux et d’une série d’autres
biens durables détenus par les ménages. En réalité, la valeur de tels services n’apparaît
pourtant pas dans le PIB. S’y ajoutent la production et la consommation domestiques, qui
ne passent jamais par le marché : par exemple, les repas préparés à la maison n’ont rien
de différent des repas consommés dans un restaurant, mais pourtant la valeur ajoutée des
repas à domicile n’apparaît pas dans le PIB.
Enfin, on n’impute pas non plus la valeur des biens et services vendus dans l’éco-
nomie souterraine. On appelle économie souterraine la partie des activités économiques
que les citoyens cachent à l’État, soit pour éluder l’impôt, soit en raison du caractère
illégal de telles activités. La rémunération des travailleurs domestiques non déclarés fait
souvent partie de la première catégorie, le trafic de drogue de la seconde. La taille de
l’économie souterraine varie d’un pays à l’autre. Ainsi, aux États-Unis l’économie souter-
raine représente moins de 10 % de l’économie officielle, alors que dans certains pays en
développement, comme la Thaïlande, le Nigeria et l’Égypte, elle est aussi importante que
l’économie officielle.
Tant le caractère souvent approximatif des imputations que l’exclusion de nom-
breux biens et services du calcul du PIB font de celui-ci une mesure imparfaite de l’acti-
vité économique. Ceci rend particulièrement difficile la comparaison des niveaux de vie
d’un pays à l’autre. L’ampleur de l’économie souterraine, notamment, n’est pas identique
dans tous les pays. Par contre, pourvu que l’importance de toutes ces approximations
demeure relativement constante dans le temps, le PIB reste utile pour comparer l’évolu-
tion de l’activité économique d’un pays d’une année sur l’autre.
2.1.3 Le PIB réel et le PIB nominal
En utilisant les règles décrites ci-dessus, les économistes calculent le PIB, qui évalue
la quantité totale de biens et services produits par une économie. Mais le PIB est-il une
bonne mesure du bien-être économique ? Reprenons le cas de l’économie ne produisant