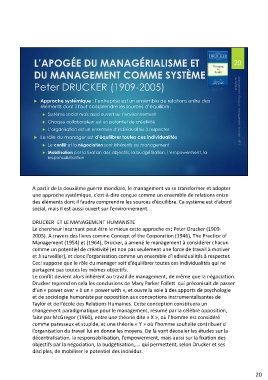Page 23 - CFPA-Management équipe et projet_Neat
P. 23
L’APOGÉE DU MANAGÉRIALISME ET 20
DU MANAGEMENT COMME SYSTÈME :
Peter DRUCKER (1909-2005)
Approche systémique : l’entreprise est un ensemble de relations entre des
éléments dont il faut comprendre les sources d’équilibre.
Système social mais aussi ouvert sur l’environnement
Chaque collaborateur est un potentiel de créativité
L’organisation est un ensemble d’individualités à respecter
Le rôle du manager est d’équilibrer toutes ces individualités
Le conflit et la négociation sont inhérents au management
Mobilisation par la fixation des objectifs, la budgétisation, l’empowerment, la
responsabilisation
A partir de la deuxième guerre mondiale, le management va se transformer et adopter
une approche systémique, c’est-à-dire conçue comme un ensemble de relations entre
des éléments dont il faudra comprendre les sources d’équilibre. Ce système est d’abord
social, mais il est aussi ouvert sur l’environnement.
DRUCKER ET LE MANAGEMENT HUMANISTE
Le chercheur incarnant peut être le mieux cette approche est Peter Drucker (1909-
2005). A travers des livres comme Concept of the Corporation (1946), The Practice of
Management (1954) et (1964), Drucker, a amené le management à considérer chacun
comme un potentiel de créativité (et non pas seulement une force de travail à motiver
et à surveiller), et donc l’organisation comme un ensemble d’individualités à respecter.
Ceci suppose que le rôle du manager soit d’équilibrer toutes ces individualités qui ne
partagent pas toutes les mêmes objectifs.
Le conflit devient alors inhérent au travail de management, de même que la négociation.
Drucker reprend en cela les conclusions de Mary Parker Follett qui préconisait de passer
d’un « power over » à un « power with », et ouvre la voie à des apports de psychologie
et de sociologie humaniste par opposition aux conceptions instrumentalisantes de
Taylor et de l’école des Relations Humaines. Cette conception constituera un
changement paradigmatique pour le management, résumé par la célèbre opposition,
faite par McGregor (1960), entre une théorie dite « X », où l’homme est considéré
comme paresseux et stupide, et une théorie « Y » où l’homme souhaite contribuer si
l’organisation du travail lui en donne les moyens. De là vont découler les études sur la
décentralisation, la responsabilisation, l’empowerment, mais aussi sur la fixation des
objectifs par la négociation, la budgétisation,…. qui permettent, selon Drucker et ses
disciples, de mobiliser le potentiel des individus.
20