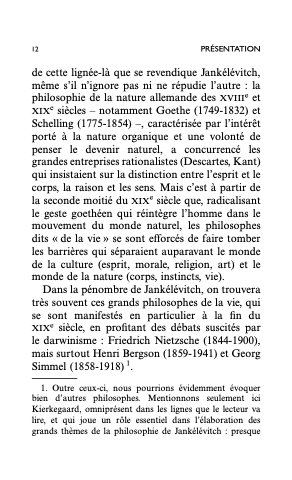Page 12 - L’aventure, l’ennui, le sérieux V. Jankélévitch
P. 12
12 PRÉSENTATION
de cette lignée-là que se revendique Jankélévitch, même s’il n’ignore pas ni ne répudie l’autre : la philosophie de la nature allemande des XVIIIe et XIXe siècles – notamment Goethe (1749-1832) et Schelling (1775-1854) –, caractérisée par l’intérêt porté à la nature organique et une volonté de penser le devenir naturel, a concurrencé les grandes entreprises rationalistes (Descartes, Kant) qui insistaient sur la distinction entre l’esprit et le corps, la raison et les sens. Mais c’est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que, radicalisant le geste goethéen qui réintègre l’homme dans le mouvement du monde naturel, les philosophes dits « de la vie » se sont efforcés de faire tomber les barrières qui séparaient auparavant le monde de la culture (esprit, morale, religion, art) et le monde de la nature (corps, instincts, vie).
Dans la pénombre de Jankélévitch, on trouvera très souvent ces grands philosophes de la vie, qui se sont manifestés en particulier à la fin du XIXe siècle, en profitant des débats suscités par le darwinisme : Friedrich Nietzsche (1844-1900), mais surtout Henri Bergson (1859-1941) et Georg Simmel (1858-1918) 1.
1. Outre ceux-ci, nous pourrions évidemment évoquer bien d’autres philosophes. Mentionnons seulement ici Kierkegaard, omniprésent dans les lignes que le lecteur va lire, et qui joue un rôle essentiel dans l’élaboration des grands thèmes de la philosophie de Jankélévitch : presque