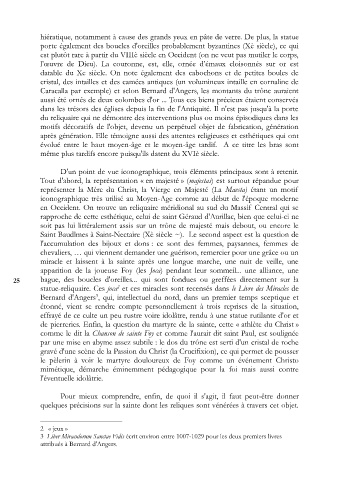Page 26 - Revue 3 A_Neat
P. 26
hiératique, notamment à cause des grands yeux en pâte de verre. De plus, la statue
porte également des boucles d'oreilles probablement byzantines (Xè siècle), ce qui
est plutôt rare à partir du VIIIè siècle en Occident (on ne veut pas mutiler le corps,
l’œuvre de Dieu). La couronne, est, elle, ornée d’émaux cloisonnés sur or est
datable du Xe siècle. On note également des cabochons et de petites boules de
cristal, des intailles et des camées antiques (un volumineux intaille en cornaline de
Caracalla par exemple) et selon Bernard d'Angers, les montants du trône auraient
aussi été ornés de deux colombes d'or ... Tous ces biens précieux étaient conservés
dans les trésors des églises depuis la fin de l'Antiquité. Il n'est pas jusqu'à la porte
du reliquaire qui ne démontre des interventions plus ou moins épisodiques dans les
motifs décoratifs de l'objet, devenu un perpétuel objet de fabrication, génération
après génération. Elle témoigne aussi des attentes religieuses et esthétiques qui ont
évolué entre le haut moyen-âge et le moyen-âge tardif. A ce titre les bras sont
même plus tardifs encore puisqu'ils datent du XVIè siècle.
D'un point de vue iconographique, trois éléments principaux sont à retenir.
Tout d'abord, la représentation « en majesté » (majestas) est surtout répandue pour
représenter la Mère du Christ, la Vierge en Majesté (La Maesta) étant un motif
iconographique très utilisé au Moyen-Age comme au début de l'époque moderne
en Occident. On trouve un reliquaire méridional au sud du Massif Central qui se
rapproche de cette esthétique, celui de saint Géraud d'Aurillac, bien que celui-ci ne
soit pas lui littéralement assis sur un trône de majesté mais debout, ou encore le
Saint Baudîmes à Saint-Nectaire (Xè siècle ~). Le second aspect est la question de
l'accumulation des bijoux et dons : ce sont des femmes, paysannes, femmes de
chevaliers, … qui viennent demander une guérison, remercier pour une grâce ou un
miracle et laissent à la sainte après une longue marche, une nuit de veille, une
apparition de la joueuse Foy (les Joca) pendant leur sommeil... une alliance, une
25 bague, des boucles d'oreilles... qui sont fondues ou greffées directement sur la
2
statue-reliquaire. Ces joca et ces miracles sont recensés dans le Livre des Miracles de
Bernard d'Angers , qui, intellectuel du nord, dans un premier temps sceptique et
3
étonné, vient se rendre compte personnellement à trois reprises de la situation,
effrayé de ce culte un peu rustre voire idolâtre, rendu à une statue rutilante d'or et
de pierreries. Enfin, la question du martyre de la sainte, cette « athlète du Christ »
comme le dit la Chanson de sainte Foy et comme l'aurait dit saint Paul, est soulignée
par une mise en abyme assez subtile : le dos du trône est serti d'un cristal de roche
gravé d'une scène de la Passion du Christ (la Crucifixion), ce qui permet de pousser
le pèlerin à voir le martyre douloureux de Foy comme un événement Christo
mimétique, démarche éminemment pédagogique pour la foi mais aussi contre
l'éventuelle idolâtrie.
Pour mieux comprendre, enfin, de quoi il s'agit, il faut peut-être donner
quelques précisions sur la sainte dont les reliques sont vénérées à travers cet objet.
2 « jeux »
3 Liber Miraculorum Sanctae Fidis écrit environ entre 1007-1029 pour les deux premiers livres
attribués à Bernard d'Angers.