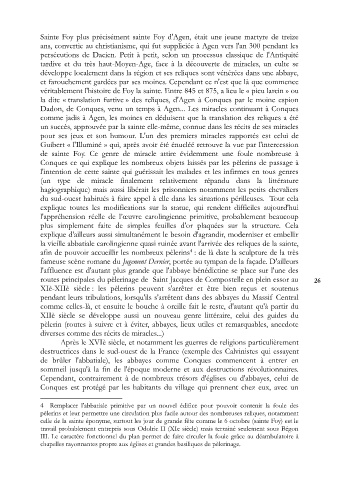Page 27 - Revue 3 A_Neat
P. 27
Sainte Foy plus précisément sainte Foy d'Agen, était une jeune martyre de treize
ans, convertie au christianisme, qui fut suppliciée à Agen vers l'an 300 pendant les
persécutions de Dacien. Petit à petit, selon un processus classique de l'Antiquité
tardive et du très haut-Moyen-Age, face à la découverte de miracles, un culte se
développe localement dans la région et ses reliques sont vénérées dans une abbaye,
et farouchement gardées par ses moines. Cependant ce n'est que là que commence
véritablement l'histoire de Foy la sainte. Entre 845 et 875, a lieu le « pieu larcin » ou
la dite « translation furtive » des reliques, d'Agen à Conques par le moine espion
Dadon, de Conques, venu un temps à Agen... Les miracles continuant à Conques
comme jadis à Agen, les moines en déduisent que la translation des reliques a été
un succès, approuvée par la sainte elle-même, connue dans les récits de ses miracles
pour ses jeux et son humour. L'un des premiers miracles rapportés est celui de
Guibert « l'Illuminé » qui, après avoir été énucléé retrouve la vue par l'intercession
de sainte Foy. Ce genre de miracle attire évidemment une foule nombreuse à
Conques ce qui explique les nombreux objets laissés par les pèlerins de passage à
l'intention de cette sainte qui guérissait les malades et les infirmes en tous genres
(un type de miracle finalement relativement répandu dans la littérature
hagiographique) mais aussi libérait les prisonniers notamment les petits chevaliers
du sud-ouest habitués à faire appel à elle dans les situations périlleuses. Tout cela
explique toutes les modifications sur la statue, qui rendent difficiles aujourd'hui
l'appréhension réelle de l’œuvre carolingienne primitive, probablement beaucoup
plus simplement faite de simples feuilles d'or plaquées sur la structure. Cela
explique d'ailleurs aussi simultanément le besoin d'agrandir, moderniser et embellir
la vieille abbatiale carolingienne quasi ruinée avant l'arrivée des reliques de la sainte,
4
afin de pouvoir accueillir les nombreux pèlerins : de là date la sculpture de la très
fameuse scène romane du Jugement Dernier, portée au tympan de la façade. D'ailleurs
l'affluence est d'autant plus grande que l'abbaye bénédictine se place sur l'une des
routes principales du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle en plein essor au 26
XIè-XIIè siècle : les pèlerins peuvent s'arrêter et être bien reçus et soutenus
pendant leurs tribulations, lorsqu'ils s'arrêtent dans des abbayes du Massif Central
comme celles-là, et ensuite le bouche à oreille fait le reste, d'autant qu'à partir du
XIIè siècle se développe aussi un nouveau genre littéraire, celui des guides du
pèlerin (routes à suivre et à éviter, abbayes, lieux utiles et remarquables, anecdote
diverses comme des récits de miracles...)
Après le XVIè siècle, et notamment les guerres de religions particulièrement
destructrices dans le sud-ouest de la France (exemple des Calvinistes qui essayent
de brûler l'abbatiale), les abbayes comme Conques commencent à entrer en
sommeil jusqu'à la fin de l'époque moderne et aux destructions révolutionnaires.
Cependant, contrairement à de nombreux trésors d'églises ou d'abbayes, celui de
Conques est protégé par les habitants du village qui prennent chez eux, avec un
4 Remplacer l'abbatiale primitive par un nouvel édifice pour pouvoir contenir la foule des
pèlerins et leur permettre une circulation plus facile autour des nombreuses reliques, notamment
celle de la sainte éponyme, surtout les jour de grande fête comme le 6 octobre (sainte Foy) est le
travail probablement entrepris sous Odolric II (XIe siècle) mais terminé seulement sous Bégon
III. Le caractère fonctionnel du plan permet de faire circuler la foule grâce au déambulatoire à
chapelles rayonnantes propre aux églises et grandes basiliques de pèlerinage.