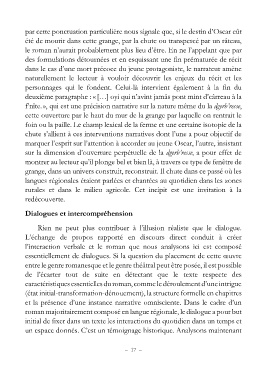Page 17 - Travail L'Oscar èt l'Alfred-etude-de-Louis-Mores
P. 17
par cette ponctuation particulière nous signale que, si le destin d’Oscar eût
été de mourir dans cette grange, par la chute ou transpercé par un râteau,
le roman n’aurait probablement plus lieu d’être. En ne l’appelant que par
des formulations détournées et en esquissant une fin prématurée de récit
dans le cas d’une mort précoce du jeune protagoniste, le narrateur amène
naturellement le lecteur à vouloir découvrir les enjeux du récit et les
personnages qui le fondent. Celui-là intervient également à la fin du
deuxième paragraphe : « […] oyi qui n’avint jamâs pont mint d’cârreau à la
f’nîte.», qui est une précision narrative sur la nature même du la dgerb’resse,
cette ouverture par le haut du mur de la grange par laquelle on rentrait le
foin ou la paille. Le champ lexical de la ferme et une certaine isotopie de la
chute s’allient à ces interventions narratives dont l’une a pour objectif de
marquer l’esprit sur l’attention à accorder au jeune Oscar, l’autre, insistant
sur la dimension d’ouverture perpétuelle de la dgerb’resse, a pour effet de
montrer au lecteur qu’il plonge bel et bien là, à travers ce type de fenêtre de
grange, dans un univers construit, reconstruit. Il chute dans ce passé où les
langues régionales étaient parlées et chantées au quotidien dans les zones
rurales et dans le milieu agricole. Cet incipit est une invitation à la
redécouverte.
Dialogues et intercompréhension
Rien ne peut plus contribuer à l’illusion réaliste que le dialogue.
L’échange de propos rapporté en discours direct conduit à créer
l’interaction verbale et le roman que nous analysons ici est composé
essentiellement de dialogues. Si la question du placement de cette œuvre
entre le genre romanesque et le genre théâtral peut être posée, il est possible
de l’écarter tout de suite en détectant que le texte respecte des
caractéristiques essentielles du roman, comme le déroulement d’une intrigue
(état initial-transformation-dénouement), la structure formelle en chapitres
et la présence d’une instance narrative omnisciente. Dans le cadre d’un
roman majoritairement composé en langue régionale, le dialogue a pour but
initial de fixer dans un texte les interactions du quotidien dans un temps et
un espace donnés. C’est un témoignage historique. Analysons maintenant
– 17 –
été de mourir dans cette grange, par la chute ou transpercé par un râteau,
le roman n’aurait probablement plus lieu d’être. En ne l’appelant que par
des formulations détournées et en esquissant une fin prématurée de récit
dans le cas d’une mort précoce du jeune protagoniste, le narrateur amène
naturellement le lecteur à vouloir découvrir les enjeux du récit et les
personnages qui le fondent. Celui-là intervient également à la fin du
deuxième paragraphe : « […] oyi qui n’avint jamâs pont mint d’cârreau à la
f’nîte.», qui est une précision narrative sur la nature même du la dgerb’resse,
cette ouverture par le haut du mur de la grange par laquelle on rentrait le
foin ou la paille. Le champ lexical de la ferme et une certaine isotopie de la
chute s’allient à ces interventions narratives dont l’une a pour objectif de
marquer l’esprit sur l’attention à accorder au jeune Oscar, l’autre, insistant
sur la dimension d’ouverture perpétuelle de la dgerb’resse, a pour effet de
montrer au lecteur qu’il plonge bel et bien là, à travers ce type de fenêtre de
grange, dans un univers construit, reconstruit. Il chute dans ce passé où les
langues régionales étaient parlées et chantées au quotidien dans les zones
rurales et dans le milieu agricole. Cet incipit est une invitation à la
redécouverte.
Dialogues et intercompréhension
Rien ne peut plus contribuer à l’illusion réaliste que le dialogue.
L’échange de propos rapporté en discours direct conduit à créer
l’interaction verbale et le roman que nous analysons ici est composé
essentiellement de dialogues. Si la question du placement de cette œuvre
entre le genre romanesque et le genre théâtral peut être posée, il est possible
de l’écarter tout de suite en détectant que le texte respecte des
caractéristiques essentielles du roman, comme le déroulement d’une intrigue
(état initial-transformation-dénouement), la structure formelle en chapitres
et la présence d’une instance narrative omnisciente. Dans le cadre d’un
roman majoritairement composé en langue régionale, le dialogue a pour but
initial de fixer dans un texte les interactions du quotidien dans un temps et
un espace donnés. C’est un témoignage historique. Analysons maintenant
– 17 –