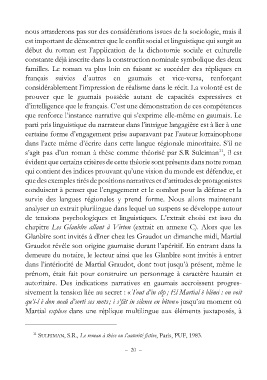Page 20 - Travail L'Oscar èt l'Alfred-etude-de-Louis-Mores
P. 20
nous attarderons pas sur des considérations issues de la sociologie, mais il
est important de démontrer que le conflit social et linguistique qui surgit au
début du roman est l’application de la dichotomie sociale et culturelle
constante déjà inscrite dans la construction nominale symbolique des deux
familles. Le roman va plus loin en faisant se succéder des répliques en
français suivies d’autres en gaumais et vice-versa, renforçant
considérablement l’impression de réalisme dans le récit. La volonté est de
prouver que le gaumais possède autant de capacités expressives et
d’intelligence que le français. C’est une démonstration de ces compétences
que renforce l’instance narrative qui s’exprime elle-même en gaumais. Le
parti pris linguistique du narrateur dans l’intrigue langagière est à lier à une
certaine forme d’engagement prise auparavant par l’auteur lorrainophone
dans l’acte même d’écrire dans cette langue régionale minoritaire. S’il ne
11
s’agit pas d’un roman à thèse comme théorisé par S.R Suleiman , il est
évident que certains critères de cette théorie sont présents dans notre roman
qui contient des indices prouvant qu’une vision du monde est défendue, et
que des exemples tirés de positions narratives et d’attitudes de protagonistes
conduisent à penser que l’engagement et le combat pour la défense et la
survie des langues régionales y prend forme. Nous allons maintenant
analyser un extrait plurilingue dans lequel un suspens se développe autour
de tensions psychologiques et linguistiques. L’extrait choisi est issu du
chapitre Les Glanbîre allant à Virton (extrait en annexe C). Alors que les
Glanbîre sont invités à dîner chez les Graudot un dimanche midi, Martial
Graudot révèle son origine gaumaise durant l’apéritif. En entrant dans la
demeure du notaire, le lecteur ainsi que les Glanbîre sont invités à entrer
dans l’intériorité de Martial Graudot, dont tout jusqu’à présent, même le
prénom, était fait pour construire un personnage à caractère hautain et
autoritaire. Des indications narratives en gaumais accroissent progres-
sivement la tension liée au secret : « Tout d’in côp ; El Martial è blémi : on voit
qu’i-l è don maû d’sorti ses mots ; i s’fât in silence en bèton» jusqu’au moment où
Martial explose dans une réplique multilingue aux éléments juxtaposés, à
11
SULEIMAN, S.R., Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, PUF, 1983.
– 20 –
est important de démontrer que le conflit social et linguistique qui surgit au
début du roman est l’application de la dichotomie sociale et culturelle
constante déjà inscrite dans la construction nominale symbolique des deux
familles. Le roman va plus loin en faisant se succéder des répliques en
français suivies d’autres en gaumais et vice-versa, renforçant
considérablement l’impression de réalisme dans le récit. La volonté est de
prouver que le gaumais possède autant de capacités expressives et
d’intelligence que le français. C’est une démonstration de ces compétences
que renforce l’instance narrative qui s’exprime elle-même en gaumais. Le
parti pris linguistique du narrateur dans l’intrigue langagière est à lier à une
certaine forme d’engagement prise auparavant par l’auteur lorrainophone
dans l’acte même d’écrire dans cette langue régionale minoritaire. S’il ne
11
s’agit pas d’un roman à thèse comme théorisé par S.R Suleiman , il est
évident que certains critères de cette théorie sont présents dans notre roman
qui contient des indices prouvant qu’une vision du monde est défendue, et
que des exemples tirés de positions narratives et d’attitudes de protagonistes
conduisent à penser que l’engagement et le combat pour la défense et la
survie des langues régionales y prend forme. Nous allons maintenant
analyser un extrait plurilingue dans lequel un suspens se développe autour
de tensions psychologiques et linguistiques. L’extrait choisi est issu du
chapitre Les Glanbîre allant à Virton (extrait en annexe C). Alors que les
Glanbîre sont invités à dîner chez les Graudot un dimanche midi, Martial
Graudot révèle son origine gaumaise durant l’apéritif. En entrant dans la
demeure du notaire, le lecteur ainsi que les Glanbîre sont invités à entrer
dans l’intériorité de Martial Graudot, dont tout jusqu’à présent, même le
prénom, était fait pour construire un personnage à caractère hautain et
autoritaire. Des indications narratives en gaumais accroissent progres-
sivement la tension liée au secret : « Tout d’in côp ; El Martial è blémi : on voit
qu’i-l è don maû d’sorti ses mots ; i s’fât in silence en bèton» jusqu’au moment où
Martial explose dans une réplique multilingue aux éléments juxtaposés, à
11
SULEIMAN, S.R., Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, PUF, 1983.
– 20 –