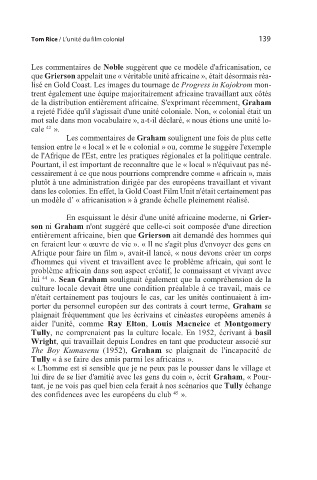Page 148 - Livre2_NC
P. 148
Tom Rice / L’unité du film colonial 139
Les commentaires de Noble suggèrent que ce modèle d'africanisation, ce
que Grierson appelait une « véritable unité africaine », était désormais réa-
lisé en Gold Coast. Les images du tournage de Progress in Kojokrom mon-
trent également une équipe majoritairement africaine travaillant aux côtés
de la distribution entièrement africaine. S'exprimant récemment, Graham
a rejeté l'idée qu'il s'agissait d'une unité coloniale. Non, « colonial était un
mot sale dans mon vocabulaire », a-t-il déclaré, « nous étions une unité lo-
cale ».
42
Les commentaires de Graham soulignent une fois de plus cette
tension entre le « local » et le « colonial » ou, comme le suggère l'exemple
de l'Afrique de l'Est, entre les pratiques régionales et la politique centrale.
Pourtant, il est important de reconnaître que le « local » n'équivaut pas né-
cessairement à ce que nous pourrions comprendre comme « africain », mais
plutôt à une administration dirigée par des européens travaillant et vivant
dans les colonies. En effet, la Gold Coast Film Unit n'était certainement pas
un modèle d’ « africanisation » à grande échelle pleinement réalisé.
En esquissant le désir d'une unité africaine moderne, ni Grier-
son ni Graham n'ont suggéré que celle-ci soit composée d'une direction
entièrement africaine, bien que Grierson ait demandé des hommes qui
en feraient leur « œuvre de vie ». « Il ne s'agit plus d'envoyer des gens en
Afrique pour faire un film », avait-il lancé, « nous devons créer un corps
d'hommes qui vivent et travaillent avec le problème africain, qui sont le
problème africain dans son aspect créatif, le connaissant et vivant avec
lui 44 ». Sean Graham soulignait également que la compréhension de la
culture locale devait être une condition préalable à ce travail, mais ce
n'était certainement pas toujours le cas, car les unités continuaient à im-
porter du personnel européen sur des contrats à court terme, Graham se
plaignait fréquemment que les écrivains et cinéastes européens amenés à
aider l'unité, comme Ray Elton, Louis Macneice et Montgomery
Tully, ne comprenaient pas la culture locale. En 1952, écrivant à basil
Wright, qui travaillait depuis Londres en tant que producteur associé sur
The Boy Kumasenu (1952), Graham se plaignait de l'incapacité de
Tully « à se faire des amis parmi les africains ».
« L'homme est si sensible que je ne peux pas le pousser dans le village et
lui dire de se lier d'amitié avec les gens du coin », écrit Graham, « Pour-
tant, je ne vois pas quel bien cela ferait à nos scénarios que Tully échange
des confidences avec les européens du club ».
45