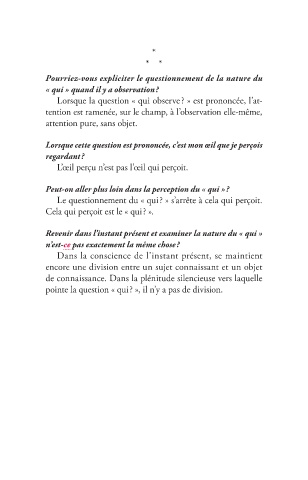Page 295 - La pratique spirituelle
P. 295
À l’inverse, lorsque la souffrance est là, il y a contraction corpo-
relle, paralysie des flux dans le corps, paralysie du corps. « Qui » *
ressent cette douleur physique ? « Qui » a mal ? « Qui » est gênée * *
par ceci ? Puisqu’il n’y a personne, et pourtant cette douleur est Pourriez-vous expliciter le questionnement de la nature du
bien là, et quelque chose la ressent vivement. « qui » quand il y a observation ?
La conscience est le support de toute perception. Le mental Lorsque la question « qui observe ? » est prononcée, l’at-
s’empare de cette dernière et la fait sienne, en l’interprétant. tention est ramenée, sur le champ, à l’observation elle-même,
Il crée un intermédiaire qui se fait passer pour le sujet-perce- attention pure, sans objet.
vant, alors qu’il n’est lui-même qu’objet. La perception est une
chose. L’interprétation en est une autre. La première appar- Lorsque cette question est prononcée, c’est mon œil que je perçois
tient à la conscience, la seconde à la mémoire. Sans mémoire, regardant ?
il y a perception, mais non mentalisation. La douleur n’est L’œil perçu n’est pas l’œil qui perçoit.
alors que sensation. S’il y a gêne, c’est qu’il y a refus.
Peut-on aller plus loin dans la perception du « qui » ?
Lorsqu’il y a refus, ce refus n’est-il pas une nouvelle perception Le questionnement du « qui ? » s’arrête à cela qui perçoit.
qui s’ajoute ? Cela qui perçoit est le « qui ? ».
Oui, il y a perception du refus.
Revenir dans l’instant présent et examiner la nature du « qui »
Le refus est-il une sensation parmi toutes les autres, qui appar- n’est-ce pas exactement la même chose ?
tient aussi à la conscience ? Dans la conscience de l’instant présent, se maintient
Oui, on peut le dire ainsi. encore une division entre un sujet connaissant et un objet
de connaissance. Dans la plénitude silencieuse vers laquelle
Et enfin, je voudrais vous demander quel est le lien entre ces pointe la question « qui ? », il n’y a pas de division.
deux perceptions qui se présentent indépendamment l’une de
l’autre. L’une emplit de « jouissance », un mouvement qui nous
pénètre et qui circule en nous avec un bien-être à nul autre com-
parable. L’autre arrive d’un coup, lorsqu’on voit (enfin !) l’inu-
tilité de toutes choses, et alors, brusquement, tout est « aplati ».
Ni sensation, ni pensée, ni perception, ni mouvement, rien du
tout. Le calme super plat. Un lac.
La jouissance-objet et l’absence d’objet sont tous deux
objets. Le regard qui les contient est ce qui les relie.
294