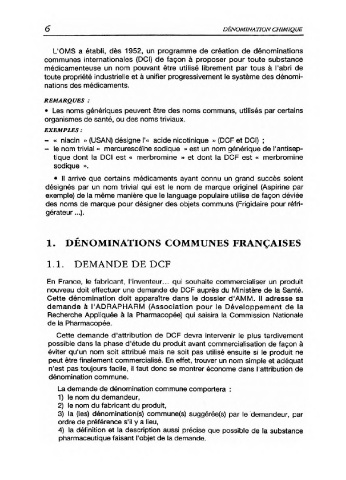Page 29 - Traité de Chimie Thérapeutique Vol1 Dénomination chimique
P. 29
6 DÉNOMINATION CHIMIQUE
L'OMS a établi, dès 1952, un programme de création de dénominations
communes internationales (DGI) de façon à proposer pour toute substance
médicamenteuse un nom pouvant être utilisé librement par tous à l’abri de
toute propriété industrielle et à unifier progressivement le système des dénomi
nations des médicaments.
REMARQUES :
• Les noms génériques peuvent être des noms communs, utilisés par certains
organismes de santé, ou des noms triviaux.
EXEMPLES :
- « niacin » (USAN) désigne l'« acide nicotinique » (DGF et DGI) ;
- le nom trivial « mercurescéïne sodique » est un nom générique de l'antisep
tique dont la DCI est « merbromine » et dont la DGF est « merbromine
sodique ».
• Il arrive que certains médicaments ayant connu un grand succès soient
désignés par un nom trivial qui est le nom de marque originel (Aspirine par
exemple) de la même manière que le language populaire utilise de façon déviée
des noms de marque pour désigner des objets communs (Frigidaire pour réfri
gérateur ...).
1. DÉNOMINATIONS COMMUNES FRANÇAISES
1.1. DEMANDE DE DCF
En France, le fabricant, l'inventeur... qui souhaite commercialiser un produit
nouveau doit effectuer une demande de DCF auprès du Ministère de la Santé.
Cette dénomination doit apparaître dans le dossier d'AMM. Il adresse sa
demande à l'ADRAPHARM (Association pour le Développement de la
Recherche Appliquée à la Pharmacopée) qui saisira la Commission Nationale
de la Pharmacopée.
Cette demande d'attribution de DCF devra intervenir le plus tardivement
possible dans la phase d'étude du produit avant commercialisation de façon à
éviter qu'un nom soit attribué mais ne soit pas utilisé ensuite si le produit ne
peut être finalement commercialisé. En effet, trouver un nom simple et adéquat
n'est pas toujours facile, il faut donc se montrer économe dans l'attribution de
dénomination commune.
La demande de dénomination commune comportera :
1) le nom du demandeur,
2) le nom du fabricant du produit,
3) la (les) dénomination(s) commune(s) suggérée(s) par le demandeur, par
ordre de préférence s'il y a lieu,
4) la définition et la description aussi précise que possible de la substance
pharmaceutique faisant l'objet de la demande.