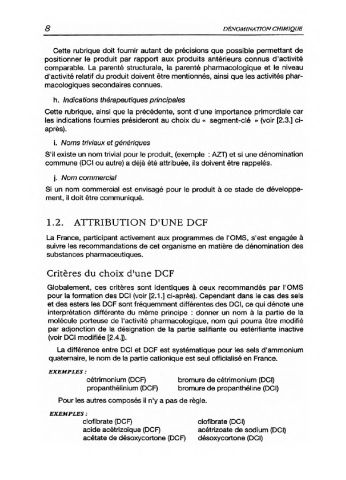Page 31 - Traité de Chimie Thérapeutique Vol1 Dénomination chimique
P. 31
8 DÉNOMINATION CHIMIQUE
Cette rubrique doit fournir autant de précisions que possible permettant de
positionner le produit par rapport aux produits antérieurs connus d'activité
comparable. La parenté structurale, la parenté pharmacologique et le niveau
d'activité relatif du produit doivent être mentionnés, ainsi que les activités phar
macologiques secondaires connues.
h. Indications thérapeutiques principales
Cette rubrique, ainsi que la précédente, sont d'une importance primordiale car
les indications fournies présideront au choix du « segment-clé » (voir [2.3.] ci-
après).
I. Noms triviaux et génériques
S'il existe un nom trivial pour le produit, (exemple : AZT) et si une dénomination
commune (DCI ou autre) a déjà été attribuée, ils doivent être rappelés.
j. Nom commercial
Si un nom commercial est envisagé pour le produit à ce stade de développe
ment, il doit être communiqué.
1.2. ATTRIBUTION D'UNE DCF
La France, participant activement aux programmes de l'OMS, s'est engagée à
suivre les recommandations de cet organisme en matière de dénomination des
substances pharmaceutiques.
Critères du choix d'une DCF
Globalement, ces critères sont identiques à ceux recommandés par l'OMS
pour la formation des DCI (voir [2.1.] ci-après). Cependant dans le cas des sels
et des esters les DCF sont fréquemment différentes des DCI, ce qui dénote une
interprétation différente du même principe : donner un nom à la partie de la
molécule porteuse de l'activité pharmacologique, nom qui pourra être modifié
par adjonction de la désignation de la partie salifiante ou estérifiante inactive
(voir DCI modifiée [2.4.]).
La différence entre DCI et DCF est systématique pour les sels d'ammonium
quaternaire, le nom de la partie cationique est seul officialisé en France.
EXEMPLES :
cétrimonium (DCF) bromure de cétrimonium (DCI)
propanthélinium (DCF) bromure de propanthéline (DCI)
Pour les autres composés il n'y a pas de règle.
EXEMPLES :
clofibrate (DCF) clofibrate (DCI)
acide acétrizoïque (DCF) acétrizoate de sodium (DCI)
acétate de désoxycortone (DCF) désoxycortone (DCI)