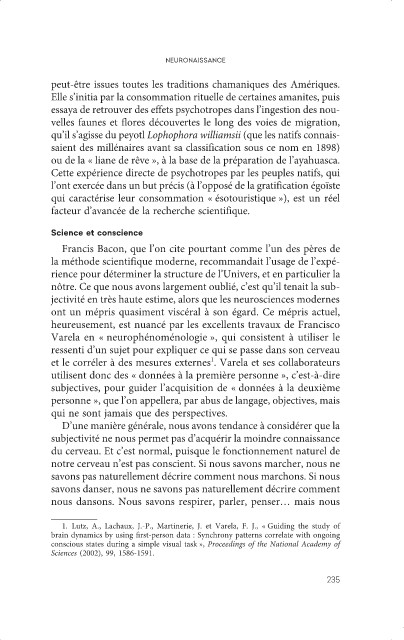Page 236 - 266687ILJ_CERVEAU_cs6_pc.indd
P. 236
NEURONAISSANCE
peut‑ être issues toutes les traditions chamaniques des Amériques.
Elle s’initia par la consommation rituelle de certaines amanites, puis
essaya de retrouver des effets psychotropes dans l’ingestion des nou‑
velles faunes et flores découvertes le long des voies de migration,
qu’il s’agisse du peyotl Lophophora williamsii (que les natifs connais‑
saient des millénaires avant sa classification sous ce nom en 1898)
ou de la « liane de rêve », à la base de la préparation de l’ayahuasca.
Cette expérience directe de psychotropes par les peuples natifs, qui
l’ont exercée dans un but précis (à l’opposé de la gratification égoïste
qui caractérise leur consommation « ésotouristique »), est un réel
facteur d’avancée de la recherche scientifique.
Science et conscience
Francis Bacon, que l’on cite pourtant comme l’un des pères de
la méthode scientifique moderne, recommandait l’usage de l’expé‑
rience pour déterminer la structure de l’Univers, et en particulier la
nôtre. Ce que nous avons largement oublié, c’est qu’il tenait la sub‑
jectivité en très haute estime, alors que les neurosciences modernes
ont un mépris quasiment viscéral à son égard. Ce mépris actuel,
heureusement, est nuancé par les excellents travaux de Francisco
Varela en « neurophénoménologie », qui consistent à utiliser le
ressenti d’un sujet pour expliquer ce qui se passe dans son cerveau
1
et le corréler à des mesures externes . Varela et ses collaborateurs
utilisent donc des « données à la première personne », c’est‑ à‑ dire
subjectives, pour guider l’acquisition de « données à la deuxième
personne », que l’on appellera, par abus de langage, objectives, mais
qui ne sont jamais que des perspectives.
D’une manière générale, nous avons tendance à considérer que la
subjectivité ne nous permet pas d’acquérir la moindre connaissance
du cerveau. Et c’est normal, puisque le fonctionnement naturel de
notre cerveau n’est pas conscient. Si nous savons marcher, nous ne
savons pas naturellement décrire comment nous marchons. Si nous
savons danser, nous ne savons pas naturellement décrire comment
nous dansons. Nous savons respirer, parler, penser… mais nous
1. Lutz, A., Lachaux, J.‑ P., Martinerie, J. et Varela, F. J., « Guiding the study of
brain dynamics by using first‑ person data : Synchrony patterns correlate with ongoing
conscious states during a simple visual task », Proceedings of the National Academy of
Sciences (2002), 99, 1586‑1591.
235
266687ILJ_CERVEAU_cs6_pc.indd 235 02/09/2016 14:39:04