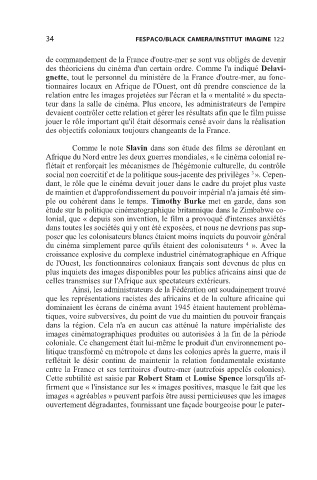Page 43 - Livre2_NC
P. 43
34 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
de commandement de la France d'outre-mer se sont vus obligés de devenir
des théoriciens du cinéma d'un certain ordre. Comme l'a indiqué Delavi-
gnette, tout le personnel du ministère de la France d'outre-mer, au fonc-
tionnaires locaux en Afrique de l'Ouest, ont dû prendre conscience de la
relation entre les images projetées sur l'écran et la « mentalité » du specta-
teur dans la salle de cinéma. Plus encore, les administrateurs de l'empire
devaient contrôler cette relation et gérer les résultats afin que le film puisse
jouer le rôle important qu'il était désormais censé avoir dans la réalisation
des objectifs coloniaux toujours changeants de la France.
Comme le note Slavin dans son étude des films se déroulant en
Afrique du Nord entre les deux guerres mondiales, « le cinéma colonial re-
flétait et renforçait les mécanismes de l'hégémonie culturelle, du contrôle
social non coercitif et de la politique sous-jacente des privilèges ». Cepen-
3
dant, le rôle que le cinéma devait jouer dans le cadre du projet plus vaste
de maintien et d'approfondissement du pouvoir impérial n'a jamais été sim-
ple ou cohérent dans le temps. Timothy Burke met en garde, dans son
étude sur la politique cinématographique britannique dans le Zimbabwe co-
lonial, que « depuis son invention, le film a provoqué d'intenses anxiétés
dans toutes les sociétés qui y ont été exposées, et nous ne devrions pas sup-
poser que les colonisateurs blancs étaient moins inquiets du pouvoir général
du cinéma simplement parce qu'ils étaient des colonisateurs ». Avec la
4
croissance explosive du complexe industriel cinématographique en Afrique
de l'Ouest, les fonctionnaires coloniaux français sont devenus de plus en
plus inquiets des images disponibles pour les publics africains ainsi que de
celles transmises sur l'Afrique aux spectateurs extérieurs.
Ainsi, les administrateurs de la Fédération ont soudainement trouvé
que les représentations racistes des africains et de la culture africaine qui
dominaient les écrans de cinéma avant 1945 étaient hautement probléma-
tiques, voire subversives, du point de vue du maintien du pouvoir français
dans la région. Cela n'a en aucun cas atténué la nature impérialiste des
images cinématographiques produites ou autorisées à la fin de la période
coloniale. Ce changement était lui-même le produit d'un environnement po-
litique transformé en métropole et dans les colonies après la guerre, mais il
reflétait le désir continu de maintenir la relation fondamentale existante
entre la France et ses territoires d'outre-mer (autrefois appelés colonies).
Cette subtilité est saisie par Robert Stam et Louise Spence lorsqu'ils af-
firment que « l'insistance sur les « images positives, masque le fait que les
images « agréables » peuvent parfois être aussi pernicieuses que les images
ouvertement dégradantes, fournissant une façade bourgeoise pour le pater-