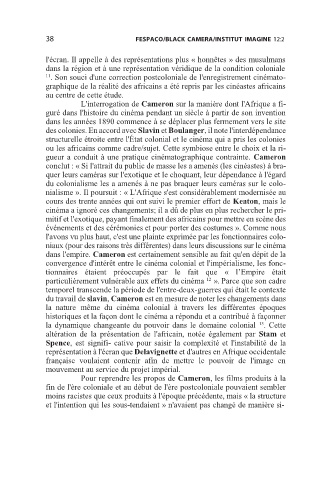Page 47 - Livre2_NC
P. 47
38 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
l'écran. Il appelle à des représentations plus « honnêtes » des musulmans
dans la région et à une représentation véridique de la condition coloniale
11 . Son souci d'une correction postcoloniale de l'enregistrement cinémato-
graphique de la réalité des africains a été repris par les cinéastes africains
au centre de cette étude.
L'interrogation de Cameron sur la manière dont l'Afrique a fi-
guré dans l'histoire du cinéma pendant un siècle à partir de son invention
dans les années 1890 commence à se déplacer plus fermement vers le site
des colonies. En accord avec Slavin et Boulanger, il note l'interdépendance
structurelle étroite entre l'État colonial et le cinéma qui a pris les colonies
ou les africains comme cadre/sujet. Cette symbiose entre le choix et la ri-
gueur a conduit à une pratique cinématographique contrainte. Cameron
conclut : « Si l'attrait du public de masse les a amenés (les cinéastes) à bra-
quer leurs caméras sur l'exotique et le choquant, leur dépendance à l'égard
du colonialisme les a amenés à ne pas braquer leurs caméras sur le colo-
nialisme ». Il poursuit : « L'Afrique s'est considérablement modernisée au
cours des trente années qui ont suivi le premier effort de Keaton, mais le
cinéma a ignoré ces changements; il a dû de plus en plus rechercher le pri-
mitif et l'exotique, payant finalement des africains pour mettre en scène des
événements et des cérémonies et pour porter des costumes ». Comme nous
l'avons vu plus haut, c'est une plainte exprimée par les fonctionnaires colo-
niaux (pour des raisons très différentes) dans leurs discussions sur le cinéma
dans l'empire. Cameron est certainement sensible au fait qu'en dépit de la
convergence d'intérêt entre le cinéma colonial et l'impérialisme, les fonc-
tionnaires étaient préoccupés par le fait que « l’Empire était
particulièrement vulnérable aux effets du cinéma ». Parce que son cadre
12
temporel transcende la période de l'entre-deux-guerres qui était le contexte
du travail de slavin, Cameron est en mesure de noter les changements dans
la nature même du cinéma colonial à travers les différentes époques
historiques et la façon dont le cinéma a répondu et a contribué à façonner
la dynamique changeante du pouvoir dans le domaine colonial . Cette
13
altération de la présentation de l'africain, notée également par Stam et
Spence, est signifi- cative pour saisir la complexité et l'instabilité de la
représentation à l'écran que Delavignette et d'autres en Afrique occidentale
française voulaient contenir afin de mettre le pouvoir de l'image en
mouvement au service du projet impérial.
Pour reprendre les propos de Cameron, les films produits à la
fin de l'ère coloniale et au début de l'ère postcoloniale pouvaient sembler
moins racistes que ceux produits à l'époque précédente, mais « la structure
et l'intention qui les sous-tendaient » n'avaient pas changé de manière si-