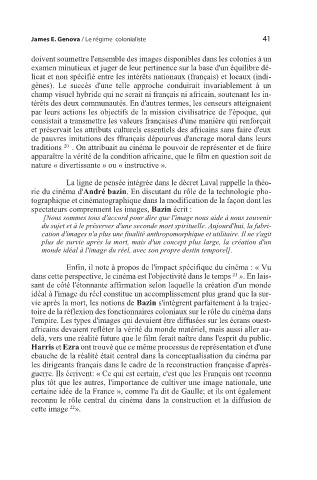Page 50 - Livre2_NC
P. 50
James E. Genova / Le régime colonialiste 41
doivent soumettre l'ensemble des images disponibles dans les colonies à un
examen minutieux et juger de leur pertinence sur la base d'un équilibre dé-
licat et non spécifié entre les intérêts nationaux (français) et locaux (indi-
gènes). Le succès d'une telle approche conduirait invariablement à un
champ visuel hybride qui ne serait ni français ni africain, soutenant les in-
térêts des deux communautés. En d'autres termes, les censeurs atteignaient
par leurs actions les objectifs de la mission civilisatrice de l'époque, qui
consistait a transmettre les valeurs françaises d'une manière qui renforçait
et préservait les attributs culturels essentiels des africains sans faire d'eux
de pauvres imitations des ffrançais dépourvus d'ancrage moral dans leurs
traditions . On attribuait au cinéma le pouvoir de représenter et de faire
20
apparaître la vérité de la condition africaine, que le film en question soit de
nature « divertissante » ou « instructive ».
La ligne de pensée intégrée dans le décret Laval rappelle la théo-
rie du cinéma d'André bazin. En discutant du rôle de la technologie pho-
tographique et cinématographique dans la modification de la façon dont les
spectateurs comprennent les images, Bazin écrit :
[Nous sommes tous d'accord pour dire que l'image nous aide à nous souvenir
du sujet et à le préserver d'une seconde mort spirituelle. Aujourd'hui, la fabri-
cation d'images n'a plus une finalité anthropomorphique et utilitaire. Il ne s'agit
plus de survie après la mort, mais d'un concept plus large, la création d'un
monde idéal à l'image du réel, avec son propre destin temporel].
Enfin, il note à propos de l'impact spécifique du cinéma : « Vu
dans cette perspective, le cinéma est l'objectivité dans le temps ». En lais-
21
sant de côté l'étonnante affirmation selon laquelle la création d'un monde
idéal à l'image du réel constitue un accomplissement plus grand que la sur-
vie après la mort, les notions de Bazin s'intègrent parfaitement à la trajec-
toire de la réflexion des fonctionnaires coloniaux sur le rôle du cinéma dans
l'empire. Les types d'images qui devaient être diffusées sur les écrans ouest-
africains devaient refléter la vérité du monde matériel, mais aussi aller au-
delà, vers une réalité future que le film ferait naître dans l'esprit du public.
Harris et Ezra ont trouvé que ce même processus de représentation et d'une
ebauche de la réalité était central dans la conceptualisation du cinéma par
les dirigeants français dans le cadre de la reconstruction française d'après-
guerre. Ils écrivent: « Ce qui est certain, c'est que les Français ont reconnu
plus tôt que les autres, l'importance de cultiver une image nationale, une
certaine idée de la France », comme l'a dit de Gaulle; et ils ont également
reconnu le rôle central du cinéma dans la construction et la diffusion de
cette image ».
22