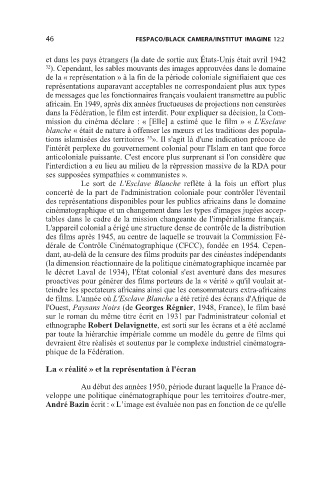Page 55 - Livre2_NC
P. 55
46 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
et dans les pays étrangers (la date de sortie aux États-Unis était avril 1942
32 ). Cependant, les sables mouvants des images approuvées dans le domaine
de la « représentation » à la fin de la période coloniale signifiaient que ces
représentations auparavant acceptables ne correspondaient plus aux types
de messages que les fonctionnaires français voulaient transmettre au public
africain. En 1949, après dix années fructueuses de projections non censurées
dans la Fédération, le film est interdit. Pour expliquer sa décision, la Com-
mission du cinéma déclare : « [Elle] a estimé que le film » « L'Esclave
blanche « était de nature à offenser les mœurs et les traditions des popula-
tions islamisées des territoires ». Il s'agit là d'une indication précoce de
33
l'intérêt perplexe du gouvernement colonial pour l'Islam en tant que force
anticoloniale puissante. C'est encore plus surprenant si l'on considère que
l'interdiction a eu lieu au milieu de la répression massive de la RDA pour
ses supposées sympathies « communistes ».
Le sort de L'Esclave Blanche reflète à la fois un effort plus
concerté de la part de l'administration coloniale pour contrôler l'éventail
des représentations disponibles pour les publics africains dans le domaine
cinématographique et un changement dans les types d'images jugées accep-
tables dans le cadre de la mission changeante de l'impérialisme français.
L'appareil colonial a érigé une structure dense de contrôle de la distribution
des films après 1945, au centre de laquelle se trouvait la Commission Fé-
dérale de Contrôle Cinématographique (CFCC), fondée en 1954. Cepen-
dant, au-delà de la censure des films produits par des cinéastes indépendants
(la dimension réactionnaire de la politique cinématographique incarnée par
le décret Laval de 1934), l'État colonial s'est aventuré dans des mesures
proactives pour générer des films porteurs de la « vérité » qu'il voulait at-
teindre les spectateurs africains ainsi que les consommateurs extra-africains
de films. L'année où L'Esclave Blanche a été retiré des écrans d'Afrique de
l'Ouest, Paysans Noirs (de Georges Régnier, 1948, France), le film basé
sur le roman du même titre écrit en 1931 par l'administrateur colonial et
ethnographe Robert Delavignette, est sorti sur les écrans et a été acclamé
par toute la hiérarchie impériale comme un modèle du genre de films qui
devraient être réalisés et soutenus par le complexe industriel cinématogra-
phique de la Fédération.
La « réalité » et la représentation à l'écran
Au début des années 1950, période durant laquelle la France dé-
veloppe une politique cinématographique pour les territoires d'outre-mer,
André Bazin écrit : « L’image est évaluée non pas en fonction de ce qu'elle