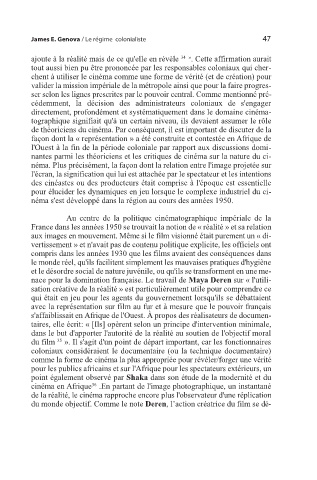Page 56 - Livre2_NC
P. 56
James E. Genova / Le régime colonialiste 47
ajoute à la réalité mais de ce qu'elle en révèle 34 » . Cette affirmation aurait
tout aussi bien pu être prononcée par les responsables coloniaux qui cher-
chent à utiliser le cinéma comme une forme de vérité (et de création) pour
valider la mission impériale de la métropole ainsi que pour la faire progres-
ser selon les lignes prescrites par le pouvoir central. Comme mentionné pré-
cédemment, la décision des administrateurs coloniaux de s'engager
directement, profondément et systématiquement dans le domaine cinéma-
tographique signifiait qu'à un certain niveau, ils devaient assumer le rôle
de théoriciens du cinéma. Par conséquent, il est important de discuter de la
façon dont la « représentation » a été construite et contestée en Afrique de
l'Ouest à la fin de la période coloniale par rapport aux discussions domi-
nantes parmi les théoriciens et les critiques de cinéma sur la nature du ci-
néma. Plus précisément, la façon dont la relation entre l'image projetée sur
l'écran, la signification qui lui est attachée par le spectateur et les intentions
des cinéastes ou des producteurs était comprise à l'époque est essentielle
pour élucider les dynamiques en jeu lorsque le complexe industriel du ci-
néma s'est développé dans la région au cours des années 1950.
Au centre de la politique cinématographique impériale de la
France dans les années 1950 se trouvait la notion de « réalité » et sa relation
aux images en mouvement. Même si le film visionné était purement un « di-
vertissement » et n'avait pas de contenu politique explicite, les officiels ont
compris dans les années 1930 que les films avaient des conséquences dans
le monde réel, qu'ils facilitent simplement les mauvaises pratiques d'hygiène
et le désordre social de nature juvénile, ou qu'ils se transforment en une me-
nace pour la domination française. Le travail de Maya Deren sur « l'utili-
sation créative de la réalité » est particulièrement utile pour comprendre ce
qui était en jeu pour les agents du gouvernement lorsqu'ils se débattaient
avec la représentation sur film au fur et à mesure que le pouvoir français
s'affaiblissait en Afrique de l'Ouest. À propos des réalisateurs de documen-
taires, elle écrit: « [Ils] opèrent selon un principe d'intervention minimale,
dans le but d'apporter l'autorité de la réalité au soutien de l'objectif moral
du film ». Il s'agit d'un point de départ important, car les fonctionnaires
35
coloniaux considéraient le documentaire (ou la technique documentaire)
comme la forme de cinéma la plus appropriée pour révéler/forger une vérité
pour les publics africains et sur l'Afrique pour les spectateurs extérieurs, un
point également observé par Shaka dans son étude de la modernité et du
cinéma en Afrique .En partant de l'image photographique, un instantané
36
de la réalité, le cinéma rapproche encore plus l'observateur d'une réplication
du monde objectif. Comme le note Deren, l’action créatrice du film se dé-