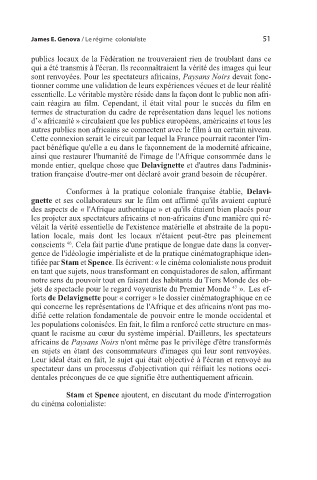Page 60 - Livre2_NC
P. 60
James E. Genova / Le régime colonialiste 51
publics locaux de la Fédération ne trouveraient rien de troublant dans ce
qui a été transmis à l'écran. Ils reconnaîtraient la vérité des images qui leur
sont renvoyées. Pour les spectateurs africains, Paysans Noirs devait fonc-
tionner comme une validation de leurs expériences vécues et de leur réalité
essentielle. Le véritable mystère réside dans la façon dont le public non afri-
cain réagira au film. Cependant, il était vital pour le succès du film en
termes de structuration du cadre de représentation dans lequel les notions
d’« africanité » circulaient que les publics européens, américains et tous les
autres publics non africains se connectent avec le film à un certain niveau.
Cette connexion serait le circuit par lequel la France pourrait raconter l'im-
pact bénéfique qu'elle a eu dans le façonnement de la modernité africaine,
ainsi que restaurer l'humanité de l'image de l'Afrique consommée dans le
monde entier, quelque chose que Delavignette et d'autres dans l'adminis-
tration française d'outre-mer ont déclaré avoir grand besoin de récupérer.
Conformes à la pratique coloniale française établie, Delavi-
gnette et ses collaborateurs sur le film ont affirmé qu'ils avaient capturé
des aspects de « l'Afrique authentique » et qu'ils étaient bien placés pour
les projeter aux spectateurs africains et non-africains d'une manière qui ré-
vélait la vérité essentielle de l'existence matérielle et abstraite de la popu-
lation locale, mais dont les locaux n'étaient peut-être pas pleinement
conscients . Cela fait partie d'une pratique de longue date dans la conver-
46
gence de l'idéologie impérialiste et de la pratique cinématographique iden-
tifiée par Stam et Spence. Ils écrivent: « le cinéma colonialiste nous produit
en tant que sujets, nous transformant en conquistadores de salon, affirmant
notre sens du pouvoir tout en faisant des habitants du Tiers Monde des ob-
jets de spectacle pour le regard voyeuriste du Premier Monde ». Les ef-
47
forts de Delavignette pour « corriger » le dossier cinématographique en ce
qui concerne les représentations de l'Afrique et des africains n'ont pas mo-
difié cette relation fondamentale de pouvoir entre le monde occidental et
les populations colonisées. En fait, le film a renforcé cette structure en mas-
quant le racisme au cœur du système impérial. D'ailleurs, les spectateurs
africains de Paysans Noirs n'ont même pas le privilège d'être transformés
en sujets en étant des consommateurs d'images qui leur sont renvoyées.
Leur idéal était en fait, le sujet qui était objectivé à l'écran et renvoyé au
spectateur dans un processus d'objectivation qui réifiait les notions occi-
dentales préconçues de ce que signifie être authentiquement africain.
Stam et Spence ajoutent, en discutant du mode d'interrogation
du cinéma colonialiste: