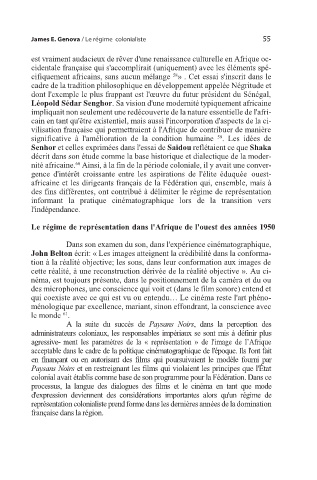Page 64 - Livre2_NC
P. 64
James E. Genova / Le régime colonialiste 55
est vraiment audacieux de rêver d'une renaissance culturelle en Afrique oc-
cidentale française qui s'accomplirait (uniquement) avec les éléments spé-
cifiquement africains, sans aucun mélange » . Cet essai s'inscrit dans le
58
cadre de la tradition philosophique en développement appelée Négritude et
dont l'exemple le plus frappant est l'œuvre du futur président du Sénégal,
Léopold Sédar Senghor. Sa vision d'une modernité typiquement africaine
impliquait non seulement une redécouverte de la nature essentielle de l'afri-
cain en tant qu'être existentiel, mais aussi l'incorporation d'aspects de la ci-
vilisation française qui permettraient à l'Afrique de contribuer de manière
significative à l'amélioration de la condition humaine . Les idées de
59
Senhor et celles exprimées dans l'essai de Saidou reflétaient ce que Shaka
décrit dans son étude comme la base historique et dialectique de la moder-
nité africaine. Ainsi, à la fin de la période coloniale, il y avait une conver-
60
gence d'intérêt croissante entre les aspirations de l'élite éduquée ouest-
africaine et les dirigeants français de la Fédération qui, ensemble, mais à
des fins différentes, ont contribué à délimiter le régime de représentation
informant la pratique cinématographique lors de la transition vers
l'indépendance.
Le régime de représentation dans l'Afrique de l'ouest des années 1950
Dans son examen du son, dans l'expérience cinématographique,
John Belton écrit: « Les images atteignent la crédibilité dans la conforma-
tion à la réalité objective; les sons, dans leur conformation aux images de
cette réalité, à une reconstruction dérivée de la réalité objective ». Au ci-
néma, est toujours présente, dans le positionnement de la caméra et du ou
des microphones, une conscience qui voit et (dans le film sonore) entend et
qui coexiste avec ce qui est vu ou entendu… Le cinéma reste l'art phéno-
ménologique par excellence, mariant, sinon effondrant, la conscience avec
le monde .
61
A la suite du succès de Paysans Noirs, dans la perception des
administrateurs coloniaux, les responsables impériaux se sont mis à définir plus
agressive- ment les paramètres de la « représentation » de l'image de l’Afrique
acceptable dans le cadre de la politique cinématographique de l'époque. Ils l'ont fait
en finançant ou en autorisant des films qui poursuivaient le modèle fourni par
Paysans Noirs et en restreignant les films qui violaient les principes que l'État
colonial avait établis comme base de son programme pour la Fédération. Dans ce
processus, la langue des dialogues des films et le cinéma en tant que mode
d'expression deviennent des considérations importantes alors qu'un régime de
représentation colonialiste prend forme dans les dernières années de la domination
française dans la région.