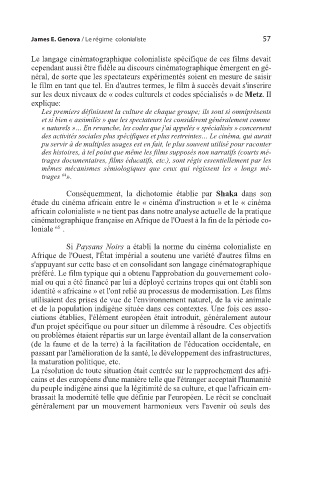Page 66 - Livre2_NC
P. 66
James E. Genova / Le régime colonialiste 57
Le langage cinématographique colonialiste spécifique de ces films devait
cependant aussi être fidèle au discours cinématographique émergent en gé-
néral, de sorte que les spectateurs expérimentés soient en mesure de saisir
le film en tant que tel. En d'autres termes, le film à succès devait s'inscrire
sur les deux niveaux de « codes culturels et codes spécialisés » de Metz. Il
explique:
Les premiers définissent la culture de chaque groupe; ils sont si omniprésents
et si bien « assimilés » que les spectateurs les considèrent généralement comme
« naturels »… En revanche, les codes que j'ai appelés « spécialisés » concernent
des activités sociales plus spécifiques et plus restreintes… Le cinéma, qui aurait
pu servir à de multiples usages est en fait, le plus souvent utilisé pour raconter
des histoires, à tel point que même les films supposés non narratifs (courts mé-
trages documentaires, films éducatifs, etc.), sont régis essentiellement par les
mêmes mécanismes sémiologiques que ceux qui régissent les « longs mé-
trages ».
64
Conséquemment, la dichotomie établie par Shaka dans son
étude du cinéma africain entre le « cinéma d'instruction » et le « cinéma
africain colonialiste » ne tient pas dans notre analyse actuelle de la pratique
cinématographique française en Afrique de l'Ouest à la fin de la période co-
loniale .
65
Si Paysans Noirs a établi la norme du cinéma colonialiste en
Afrique de l'Ouest, l'État impérial a soutenu une variété d'autres films en
s'appuyant sur cette base et en consolidant son langage cinématographique
préféré. Le film typique qui a obtenu l'approbation du gouvernement colo-
nial ou qui a été financé par lui a déployé certains tropes qui ont établi son
identité « africaine » et l'ont relié au processus de modernisation. Les films
utilisaient des prises de vue de l'environnement naturel, de la vie animale
et de la population indigène située dans ces contextes. Une fois ces asso-
ciations établies, l'élément européen était introduit, généralement autour
d'un projet spécifique ou pour situer un dilemme à résoudre. Ces objectifs
ou problèmes étaient répartis sur un large éventail allant de la conservation
(de la faune et de la terre) à la facilitation de l'éducation occidentale, en
passant par l'amélioration de la santé, le développement des infrastructures,
la maturation politique, etc.
La résolution de toute situation était centrée sur le rapprochement des afri-
cains et des européens d'une manière telle que l'étranger acceptait l'humanité
du peuple indigène ainsi que la légitimité de sa culture, et que l'africain em-
brassait la modernité telle que définie par l'européen. Le récit se concluait
généralement par un mouvement harmonieux vers l'avenir où seuls des