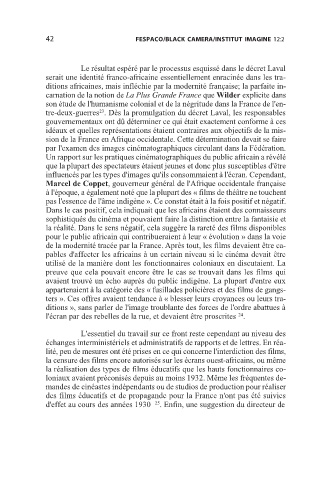Page 51 - Livre2_NC
P. 51
42 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
Le résultat espéré par le processus esquissé dans le décret Laval
serait une identité franco-africaine essentiellement enracinée dans les tra-
ditions africaines, mais infléchie par la modernité française; la parfaite in-
carnation de la notion de La Plus Grande France que Wilder explicite dans
son étude de l'humanisme colonial et de la négritude dans la France de l'en-
tre-deux-guerres . Dès la promulgation du décret Laval, les responsables
23
gouvernementaux ont dû déterminer ce qui était exactement conforme à ces
idéaux et quelles représentations étaient contraires aux objectifs de la mis-
sion de la France en Afrique occidentale. Cette détermination devait se faire
par l'examen des images cinématographiques circulant dans la Fédération.
Un rapport sur les pratiques cinématographiques du public africain a révélé
que la plupart des spectateurs étaient jeunes et donc plus susceptibles d'être
influencés par les types d'images qu'ils consommaient à l'écran. Cependant,
Marcel de Coppet, gouverneur général de l'Afrique occidentale française
à l'époque, a également noté que la plupart des « films de théâtre ne touchent
pas l'essence de l'âme indigène ». Ce constat était à la fois positif et négatif.
Dans le cas positif, cela indiquait que les africains étaient des connaisseurs
sophistiqués du cinéma et pouvaient faire la distinction entre la fantaisie et
la réalité. Dans le sens négatif, cela suggère la rareté des films disponibles
pour le public africain qui contribueraient à leur « évolution » dans la voie
de la modernité tracée par la France. Après tout, les films devaient être ca-
pables d'affecter les africains à un certain niveau si le cinéma devait être
utilisé de la manière dont les fonctionnaires coloniaux en discutaient. La
preuve que cela pouvait encore être le cas se trouvait dans les films qui
avaient trouvé un écho auprès du public indigène. La plupart d'entre eux
appartenaient à la catégorie des « fusillades policières et des films de gangs-
ters ». Ces offres avaient tendance à « blesser leurs croyances ou leurs tra-
ditions », sans parler de l'image troublante des forces de l'ordre abattues à
l'écran par des rebelles de la rue, et devaient être proscrites .
24
L'essentiel du travail sur ce front reste cependant au niveau des
échanges interministériels et administratifs de rapports et de lettres. En réa-
lité, peu de mesures ont été prises en ce qui concerne l'interdiction des films,
la censure des films encore autorisés sur les écrans ouest-africains, ou même
la réalisation des types de films éducatifs que les hauts fonctionnaires co-
loniaux avaient préconisés depuis au moins 1932. Même les fréquentes de-
mandes de cinéastes indépendants ou de studios de production pour réaliser
des films éducatifs et de propagande pour la France n'ont pas été suivies
d'effet au cours des années 1930 . Enfin, une suggestion du directeur de
25