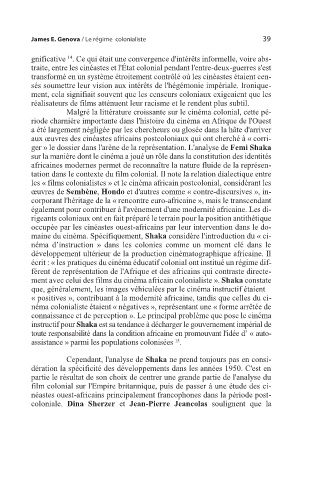Page 48 - Livre2_NC
P. 48
James E. Genova / Le régime colonialiste 39
gnificative . Ce qui était une convergence d'intérêts informelle, voire abs-
14
traite, entre les cinéastes et l'État colonial pendant l'entre-deux-guerres s'est
transformé en un système étroitement contrôlé où les cinéastes étaient cen-
sés soumettre leur vision aux intérêts de l'hégémonie impériale. Ironique-
ment, cela signifiait souvent que les censeurs coloniaux exigeaient que les
réalisateurs de films atténuent leur racisme et le rendent plus subtil.
Malgré la littérature croissante sur le cinéma colonial, cette pé-
riode charnière importante dans l'histoire du cinéma en Afrique de l'Ouest
a été largement négligée par les chercheurs ou glosée dans la hâte d'arriver
aux œuvres des cinéastes africains postcoloniaux qui ont cherché à « corri-
ger » le dossier dans l'arène de la représentation. L'analyse de Femi Shaka
sur la manière dont le cinéma a joué un rôle dans la constitution des identités
africaines modernes permet de reconnaître la nature fluide de la représen-
tation dans le contexte du film colonial. Il note la relation dialectique entre
les « films colonialistes » et le cinéma africain postcolonial, considérant les
œuvres de Sembène, Hondo et d'autres comme « contre-discursives », in-
corporant l'héritage de la « rencontre euro-africaine », mais le transcendant
également pour contribuer à l'avènement d'une modernité africaine. Les di-
rigeants coloniaux ont en fait préparé le terrain pour la position antithétique
occupée par les cinéastes ouest-africains par leur intervention dans le do-
maine du cinéma. Spécifiquement, Shaka considère l'introduction du « ci-
néma d’instruction » dans les colonies comme un moment clé dans le
développement ultérieur de la production cinématographique africaine. Il
écrit : « les pratiques du cinéma éducatif colonial ont institué un régime dif-
férent de représentation de l'Afrique et des africains qui contraste directe-
ment avec celui des films du cinéma africain colonialiste ». Shaka constate
que, généralement, les images véhiculées par le cinéma instructif étaient
« positives », contribuant à la modernité africaine, tandis que celles du ci-
néma colonialiste étaient « négatives », représentant une « forme arrêtée de
connaissance et de perception ». Le principal problème que pose le cinéma
instructif pour Shaka est sa tendance à décharger le gouvernement impérial de
toute responsabilité dans la condition africaine en promouvant l'idée d’ « auto-
assistance » parmi les populations colonisées .
15
Cependant, l'analyse de Shaka ne prend toujours pas en consi-
dération la spécificité des développements dans les années 1950. C'est en
partie le résultat de son choix de centrer une grande partie de l'analyse du
film colonial sur l'Empire britannique, puis de passer à une étude des ci-
néastes ouest-africains principalement francophones dans la période post-
coloniale. Dina Sherzer et Jean-Pierre Jeancolas soulignent que la