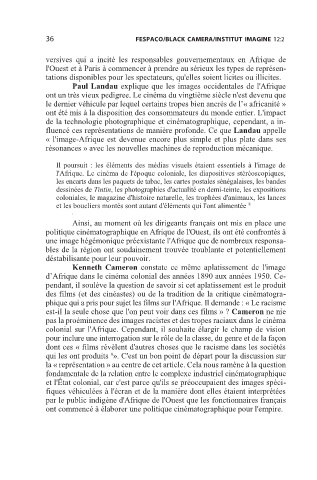Page 45 - Livre2_NC
P. 45
36 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
versives qui a incité les responsables gouvernementaux en Afrique de
l'Ouest et à Paris à commencer à prendre au sérieux les types de représen-
tations disponibles pour les spectateurs, qu'elles soient licites ou illicites.
Paul Landau explique que les images occidentales de l'Afrique
ont un très vieux pedigree. Le cinéma du vingtième siècle n'est devenu que
le dernier véhicule par lequel certains tropes bien ancrés de l’« africanité »
ont été mis à la disposition des consommateurs du monde entier. L'impact
de la technologie photographique et cinématographique, cependant, a in-
fluencé ces représentations de manière profonde. Ce que Landau appelle
« l'image-Afrique est devenue encore plus simple et plus plate dans ses
résonances » avec les nouvelles machines de reproduction mécanique.
Il poursuit : les éléments des médias visuels étaient essentiels à l'image de
l'Afrique. Le cinéma de l'époque coloniale, les diapositives stéréoscopiques,
les encarts dans les paquets de tabac, les cartes postales sénégalaises, les bandes
dessinées de Tintin, les photographies d'actualité en demi-teinte, les expositions
coloniales, le magazine d'histoire naturelle, les trophées d'animaux, les lances
et les boucliers montés sont autant d'éléments qui l'ont alimentée 8
.
Ainsi, au moment où les dirigeants français ont mis en place une
politique cinématographique en Afrique de l'Ouest, ils ont été confrontés à
une image hégémonique préexistante l'Afrique que de nombreux responsa-
bles de la région ont soudainement trouvée troublante et potentiellement
déstabilisante pour leur pouvoir.
Kenneth Cameron constate ce même aplatissement de l'image
d’Afrique dans le cinéma colonial des années 1890 aux années 1950. Ce-
pendant, il soulève la question de savoir si cet aplatissement est le produit
des films (et des cinéastes) ou de la tradition de la critique cinématogra-
phique qui a pris pour sujet les films sur l'Afrique. Il demande : « Le racisme
est-il la seule chose que l'on peut voir dans ces films » ? Cameron ne nie
pas la proéminence des images racistes et des tropes raciaux dans le cinéma
colonial sur l'Afrique. Cependant, il souhaite élargir le champ de vision
pour inclure une interrogation sur le rôle de la classe, du genre et de la façon
dont ces « films révèlent d'autres choses que le racisme dans les sociétés
qui les ont produits ». C'est un bon point de départ pour la discussion sur
9
la « représentation » au centre de cet article. Cela nous ramène à la question
fondamentale de la relation entre le complexe industriel cinématographique
et l'État colonial, car c'est parce qu'ils se préoccupaient des images spéci-
fiques véhiculées à l'écran et de la manière dont elles étaient interprétées
par le public indigène d'Afrique de l'Ouest que les fonctionnaires français
ont commencé à élaborer une politique cinématographique pour l'empire.