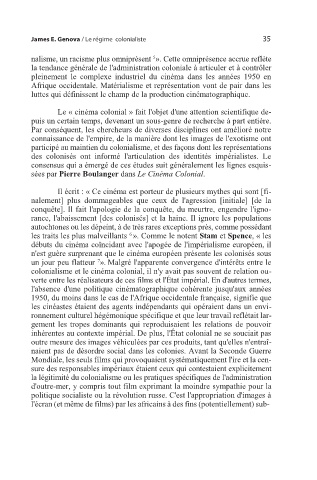Page 44 - Livre2_NC
P. 44
James E. Genova / Le régime colonialiste 35
nalisme, un racisme plus omniprésent ». Cette omniprésence accrue reflète
5
la tendance générale de l'administration coloniale à articuler et à contrôler
pleinement le complexe industriel du cinéma dans les années 1950 en
Afrique occidentale. Matérialisme et représentation vont de pair dans les
luttes qui définissent le champ de la production cinématographique.
Le « cinéma colonial » fait l'objet d'une attention scientifique de-
puis un certain temps, devenant un sous-genre de recherche à part entière.
Par conséquent, les chercheurs de diverses disciplines ont amélioré notre
connaissance de l'empire, de la manière dont les images de l'exotisme ont
participé au maintien du colonialisme, et des façons dont les représentations
des colonisés ont informé l'articulation des identités impérialistes. Le
consensus qui a émergé de ces études suit généralement les lignes esquis-
sées par Pierre Boulanger dans Le Cinéma Colonial.
Il écrit : « Ce cinéma est porteur de plusieurs mythes qui sont [fi-
nalement] plus dommageables que ceux de l'agression [initiale] [de la
conquête]. Il fait l'apologie de la conquête, du meurtre, engendre l'igno-
rance, l'abaissement [des colonisés] et la haine. Il ignore les populations
autochtones ou les dépeint, à de très rares exceptions près, comme possédant
les traits les plus malveillants ». Comme le notent Stam et Spence, « les
6
débuts du cinéma coïncidant avec l'apogée de l'impérialisme européen, il
n'est guère surprenant que le cinéma européen présente les colonisés sous
un jour peu flatteur ». Malgré l'apparente convergence d'intérêts entre le
7
colonialisme et le cinéma colonial, il n'y avait pas souvent de relation ou-
verte entre les réalisateurs de ces films et l'État impérial. En d'autres termes,
l'absence d'une politique cinématographique cohérente jusqu'aux années
1950, du moins dans le cas de l'Afrique occidentale française, signifie que
les cinéastes étaient des agents indépendants qui opéraient dans un envi-
ronnement culturel hégémonique spécifique et que leur travail reflétait lar-
gement les tropes dominants qui reproduisaient les relations de pouvoir
inhérentes au contexte impérial. De plus, l'État colonial ne se souciait pas
outre mesure des images véhiculées par ces produits, tant qu'elles n'entraî-
naient pas de désordre social dans les colonies. Avant la Seconde Guerre
Mondiale, les seuls films qui provoquaient systématiquement l'ire et la cen-
sure des responsables impériaux étaient ceux qui contestaient explicitement
la légitimité du colonialisme ou les pratiques spécifiques de l'administration
d'outre-mer, y compris tout film exprimant la moindre sympathie pour la
politique socialiste ou la révolution russe. C'est l'appropriation d'images à
l'écran (et même de films) par les africains à des fins (potentiellement) sub-