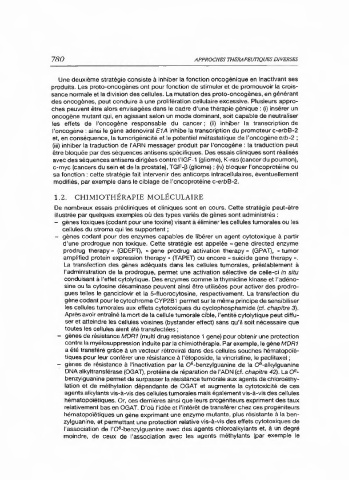Page 822 - Traité de chimie thérapeutique 6 Médicaments antitumoraux
P. 822
780 APPROCHES THÉRAPEUTIQUES DIVERSES
Une deuxième stratégie consiste à inhiber la fonction oncogénique en inactivant ses
produits. Les proto-oncogènes ont pour fonction de stimuler et de promouvoir la crois-
sance normale et la division des cellules. La mutation des proto-oncogènes, en générant
des oncogènes, peut conduire à une prolifération cellulaire excessive. Plusieurs appro-
ches peuvent être alors envisagées dans le cadre d'une thérapie génique : (i) insérer un
oncogène mutant qui, en agissant selon un mode dominant, soit capable de neutraliser
les effets de l'oncogène responsable du cancer ; (ii) inhiber la transcription de
l'oncogène: ainsi le gène adenoviral E1A inhibe la transcription du promoteur c-erbB-2
et, en conséquence, la tumorigénicité et le potentiel métastatique de l'oncogène erb-2;
(iii) inhiber la traduction de l'ARN messager produit par l'oncogène: la traduction peut
être bloquée par des séquences antisens spécifiques. Des essais cliniques sont réalisés
avec des séquences antisens dirigées contre l'IGF-1 (gliome), K-ras (cancer du poumon),
c-myc (cancers du sein et de la prostate), TGF-13 (gliome) ; (iv) bloquer l'oncoprotéine ou
sa fonction : cette stratégie fait intervenir des anticorps intracellulaires, éventuellement
modifiés, par exemple dans le ciblage de l'oncoprotéine c-erbB-2.
1.2. CHIMIOTHÉRAPIE MOLÉCULAIRE
De nombreux essais précliniques et cliniques sont en cours. Cette stratégie peut-être
illustrée par quelques exemples où des types variés de gènes sont administrés :
- gènes toxiques (codant pour une toxine) visant à éliminer les cellules tumorales ou les
cellules du stroma qui les supportent ;
- gènes codant pour des enzymes capables de libérer un agent cytotoxique à partir
d'une prodrogue non toxique. Cette stratégie est appelée « gene directed enzyme
prodrug therapy » (GDEPT), « gene prodrug activation therapy » (GPAT), « tumor
amplified protein expression therapy » (TAPET ou encore « suicide gene therapy •
La transfection des gènes adéquats dans les cellules tumorales, préalablement à
l'administration de la prodrogue, permet une activation sélective de celle-ci in situ
conduisant à l'effet cytolytique. Des enzymes comme la thymidine kinase et l'adéno-
sine ou la cytosine désaminase peuvent ainsi être utilisées pour activer des prodro-
gues telles le ganciclovir et la 5-fluorocytosine, respectivement. La transfection du
gène codant pour le cytochrome CYP2B1 permet sur le même principe de sensibiliser
les cellules tumorales aux effets cytotoxiques du cyclophosphamide (cf. chapitre 3).
Après avoir entraîné la mort de la cellule tumorale cible, l'entité cytolytique peut diffu-
ser et atteindre les cellules voisines (bystander affect) sans qu'il soit nécessaire que
toutes les cellules aient été transfectées ;
gènes de résistance MDR1 (multi drug resistance 1 gene) pour obtenir une protection
contre la myélosuppression induite par la chimiothérapie. Par exemple, le gène MDR1
a été transféré grâce à un vecteur rétroviral dans des cellules souches hématopoié-
tiques pour leur conférer une résistance à l'étoposide, la vincristine, le paclitaxel ;
gènes de résistance à l'inactivation par la OP-benzylguanine de la O°-alkylguanine
DNA alkyltransférase (OGAT), protéine de réparation de l'ADN (cf. chapitre 42). La O°-
benzylguanine permet de surpasser la résistance tumorale aux agents de chloroéthy-
lation et de méthylation dépendante de OGAT et augmente la cytotoxicité de ces
agents alkylants vis-à-vis des cellules tumorales mais également vis-à-vis des cellules
hématopoïétiques. Or, ces dernières ainsi que leurs progéniteurs expriment des taux
relativement bas en OGAT. D'où l'idée et l'intérêt de transférer chez ces progéniteurs
hématopoïétiques un gène exprimant une enzyme mutante, plus résistante à la ben-
zyguanine, et permettant une protection relative vis-à-vis des effets cytotoxiques de
l'association de l'O-benzylguanine avec des agents chloroalkylants et, à un degré
moindre, de ceux de l'association avec les agents méthylants (par exemple le