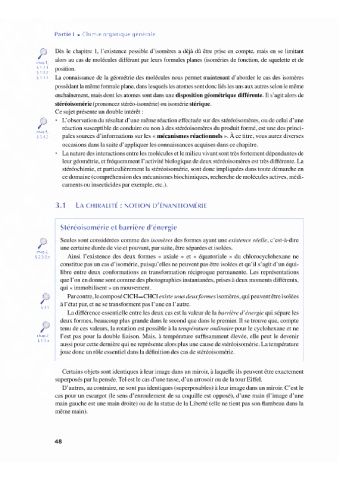Page 69 - Chimie organique - cours de Pau 2- Brigitte Jamart
P. 69
Partie 1 ■ Chimie organique générale
p Dès le chapitre 1, l'existence possible d'isomères a déjà dû être prise en compte, mais en se limitant
alors au cas de molécules différant par leurs formules planes (isoméries de fonction, de squelette et de
chap.1,
§ 1.3.1
position.
§ 1.3.2
§ 1.3.3 La connaissance de la géométrie des molécules nous permet maintenant d'aborder le cas des isomères
possédant la même formule plane, dans lesquels les atomes sont donc liés les uns aux autres selon le même
enchaînement, mais dont les atomes sont dans une disposition géométrique différente. Il s'agit alors de
stéréoisomérie (prononcez stéréo-isomérie) ou isomérie stérique.
Ce sujet présente un double intérêt :
2 • L'observation du résultat d'une même réaction effectuée sur des stéréoisomères, ou de celui d'une
chap.5, réaction susceptible de conduire ou non à des stéréoisomères du produit formé, est une des princi-
§ 5.4.2 pales sources d'informations sur les « mécanismes réactionnels». À ce titre, vous aurez diverses
occasions dans la suite d'appliquer les connaissances acquises dans ce chapitre.
• La nature des interactions entre les molécules et le milieu vivant sont très fortement dépendantes de
leur géométrie, et fréquemment l'activité biologique de deux stéréoisomères est très différente. La
stéréochimie, et particulièrement la stéréoisomérie, sont donc impliquées dans toute démarche en
ce domaine (compréhension des mécanismes biochimiques, recherche de molécules actives, médi-
caments ou insecticides par exemple, etc.).
3.1 LA CHIRALITÉ : NOTION D'ÉNANTIOMÉRIE
Stéréoisomérie et barrière d'énergie
p Seules sont considérées comme des isomères des formes ayant une existence réelle, c'est-à-dire
une certaine durée de vie et pouvant, par suite, être séparées et isolées.
chap.2,
§ 2.3.2.a Ainsi l'existence des deux formes « axiale » et « équatoriale » du chlorocyclohexane ne
constitue pas un cas d'isomérie, puisqu'elles ne peuvent pas être isolées et qu'il s'agit d'un équi-
libre entre deux conformations en transformation réciproque permanente. Les représentations
quel' on en donne sont comme des photographies instantanées, prises à deux moments différents,
qui «immobilisent» un mouvement.
> Par contre, le composé CICH=CHCIexiste sous deuxformes isomères, qui peuvent être isolées
§ 3.5 à l'état pur, et ne se transforment pas l'une en l'autre.
La différence essentielle entre les deux cas est la valeur de la barrière d'énergie qui sépare les
deux formes, beaucoup plus grande dans le second que dans le premier. Il se trouve que, compte
2 tenu de ces valeurs, la rotation est possible à la température ordinaire pour le cyclohexane et ne
chap.2, l'est pas pour la double liaison. Mais, à température suffisamment élevée, elle peut le devenir
§ 3.3.a
aussi pour cette dernière qui ne représente alors plus une cause de stéréoisomérie. La température
joue donc un rôle essentiel dans la définition des cas de stéréoisomérie.
Certains objets sont identiques à leur image dans un miroir, à laquelle ils peuvent être exactement
superposés par la pensée. Tel est le cas d'une tasse, d'un arrosoir ou de la tour Eiffel.
D'autres, au contraire, ne sont pas identiques (superposables) à leur image dans un miroir. C'est le
cas pour un escargot (le sens d'enroulement de sa coquille est opposé), d'une main (l'image d'une
main gauche est une main droite) ou de la statue de la Liberté (elle ne tient pas son flambeau dans la
même main).
48