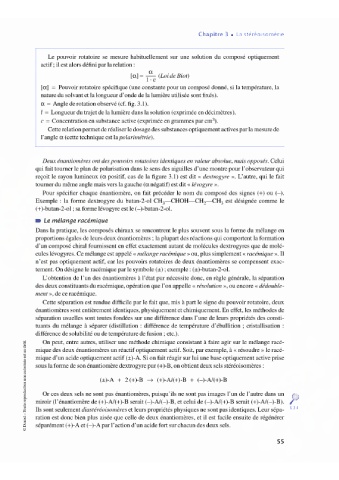Page 76 - Chimie organique - cours de Pau 2- Brigitte Jamart
P. 76
Chapitre 3 ■ La stéréoisomérie
Le pouvoir rotatoire se mesure habituellement sur une solution du composé optiquement
actif; il est alors défini par la relation :
to)=,-" t oi de Bio
·C
[a] = Pouvoir rotatoire spécifique (une constante pour un composé donné, si la température, la
nature du solvant et la longueur d'onde de la lumière utilisée sont fixés).
.= Angle de rotation observé (cf. fig. 3.1).
l = Longueur du trajet de la lumière dans la solution (exprimée en décimètres).
c = Concentration en substance active (exprimée en grammes par cm?).
Cette relation permet de réaliser le dosage des substances optiquement actives par la mesure de
l'angle a (cette technique est la polarimétrie).
Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires identiques en valeur absolue, mais opposés. Celui
qui fait tourner le plan de polarisation dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'observateur qui
reçoit le rayon lumineux (a positif, cas de la figure 3.1) est dit « dextrogyre ». L'autre, qui le fait
tourner du même angle mais vers la gauche (a négatif) est dit « lévogyre ».
Pour spécifier chaque énantiomère, on fait précéder le nom du composé des signes (+)ou(-).
Exemple : la forme dextrogyre du butan-2-0l CH,CHOH CH,CH, est désignée comme le
(+)-butan-2-ol; sa forme lévogyre est le (-)-butan-2-ol.
Le mélange racémique
Dans la pratique, les composés chiraux se rencontrent le plus souvent sous la forme du mélange en
proportions égales de leurs deux énantiomères ; la plupart des réactions qui comportent la formation
d'un composé chiral fournissent en effet exactement autant de molécules dextrogyres que de molé-
cules lévogyres. Ce mélange est appelé « mélange racémique» ou, plus simplement « racémique ». Il
n'est pas optiquement actif, car les pouvoirs rotatoires de deux énantiomères se compensent exac-
tement. On désigne le racémique par le symbole(±); exemple: (±)-butan-2-ol.
L'obtention de l'un des énantiomères à l'état pur nécessite donc, en règle générale, la séparation
des deux constituants du racémique, opération quel' on appelle « résolution », ou encore «dédouble-
ment», de ce racémique.
Cette séparation est rendue difficile par le fait que, mis à part le signe du pouvoir rotatoire, deux
énantiomères sont entièrement identiques, physiquement et chimiquement. En effet, les méthodes de
séparation usuelles sont toutes fondées sur une différence dans l'une de leurs propriétés des consti-
tuants du mélange à séparer (distillation : différence de température d'ébullition ; cristallisation :
différence de solubilité ou de température de fusion; etc.).
On peut, entre autres, utiliser une méthode chimique consistant à faire agir sur le mélange racé-
mique des deux énantiomères un réactif optiquement actif. Soit, par exemple, à « résoudre » le racé-
mique d'un acide optiquement actif (±)-A. Si on fait réagir sur lui une base optiquement active prise
sous la forme de son énantiomère dextrogyre pur (+)-B, on obtient deux sels stéréoisomères :
(±)-A + 2 (+)-B ➔ (+)-A/(+)-B + (-)-A/(+)-B
Or ces deux sels ne sont pas énantiomères, puisqu'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un
miroir (l'énantiomère de (+)-A/(+)-B serait (-)-A/(-)-B, et celui de (-)-A/(+)-B serait (+)-A/(-)-B). 2
Ils sont seulement diastéréoisomères et leurs propriétés physiques ne sont pas identiques. Leur sépa- § 3.4
ration est donc bien plus aisée que celle de deux énantiomères, et il est facile ensuite de régénérer
séparément (+)-A et (-)-A par l'action d'un acide fort sur chacun des deux sels.
55