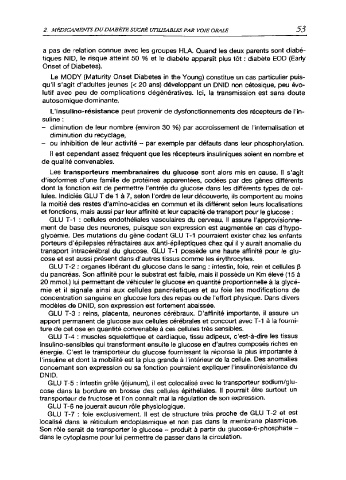Page 92 - Traité de Chimie Thérapeutique 4 Médicaments en relation avec des systèmes hormonaux
P. 92
2 MÉDICAMENTS DU DIABÈTE SUCRÉ UTILISABLES PAR VOIE ORALE 53
a pas de relation connue avec les groupes HLA. Quand les deux parents sont diabé
tiques NID, le risque atteint 50 % et le diabète apparaît plus tôt : diabète EOD (Early
Onset of Diabètes).
Le MODY (Maturity Onset Diabètes in the Young) constitue un cas particulier puis
qu'il s'agit d'adultes jeunes (< 20 ans) développant un DNID non cétosique, peu évo
lutif avec peu de complications dégénératives. Ici, la transmission est sans doute
autosomique dominante.
L'insulino-résistance peut provenir de dysfonctionnements des récepteurs de l'in
suline :
- diminution de leur nombre (environ 30 %) par accroissement de l'internalisation et
diminution du recyclage,
- ou inhibition de leur activité - par exemple par défauts dans leur phosphorylation.
Il est cependant assez fréquent que les récepteurs insuliniques soient en nombre et
de qualité convenables.
Les transporteurs membranaires du glucose sont alors mis en cause. Il s’agit
d'isoformes d'une famille de protéines apparentées, codées par des gènes différents
dont la fonction est de permettre l'entrée du glucose dans les différents types de cel
lules. Indiciés GLU T de 1 à 7, selon l'ordre de leur découverte, ils comportent au moins
la moitié des restes d'amino-acides en commun et ils différent selon leurs localisations
et fonctions, mais aussi par leur affinité et leur capacité de transport pour le glucose :
GLU T-1 : cellules endothéliales vasculaires du cerveau. Il assure l'approvisionne
ment de base des neurones, puisque son expression est augmentée en cas d'hypo
glycémie. Des mutations du gène codant GLU T-1 pourraient exister chez les enfants
porteurs d’épilepsies réfractaires aux anti-épileptiques chez qui il y aurait anomalie du
transport intracérébral du glucose. GLU T-1 possède une haute affinité pour le glu
cose et est aussi présent dans d'autres tissus comme les érythrocytes.
GLU T-2 : organes libérant du glucose dans le sang : intestin, foie, rein et cellules P
du pancréas. Son affinité pour le substrat est faible, mais il possède un Km élevé (15 à
20 mmol.) lui permettant de véhiculer le glucose en quantité proportionnelle à la glycé
mie et il signale ainsi aux cellules pancréatiques et au foie les modifications de
concentration sanguine en glucose lors des repas ou de l'effort physique. Dans divers
modèles de DNID, son expression est fortement abaissée.
GLU T-3 : reins, placenta, neurones cérébraux. D'affinité importante, il assure un
apport permanent de glucose aux cellules cérébrales et concourt avec T-1 à la fourni
ture de cet ose en quantité convenable à ces cellules très sensibles.
GLU T-4 : muscles squelettique et cardiaque, tissu adipeux, c'est-à-dire les tissus
insulino-sensibles qui transforment ensuite le glucose en d'autres composés riches en
énergie. C'est le transporteur du glucose fournissant la réponse la plus importante à
l'insuline et dont la mobilité est la plus grande à l'intérieur de la cellule. Des anomalies
concernant son expression ou sa fonction pourraient expliquer l'insulinorésistance du
DNID.
GLU T-5 : intestin grêle (jéjunum), il est colocalisé avec le transporteur sodium/glu-
cose dans la bordure en brosse des cellules épithéliales. Il pourrait être surtout un
transporteur de fructose et l'on connaît mal la régulation de son expression.
GLU T-6 ne jouerait aucun rôle physiologique.
GLU T-7 : foie exclusivement. Il est de structure très proche de GLU T-2 et est
localisé dans le réticulum endoplasmique et non pas dans la membrane plasmique.
Son rôle serait de transporter le glucose - produit à partir du glucose-6-phosphate -
dans le cytoplasme pour lui permettre de passer dans la circulation.