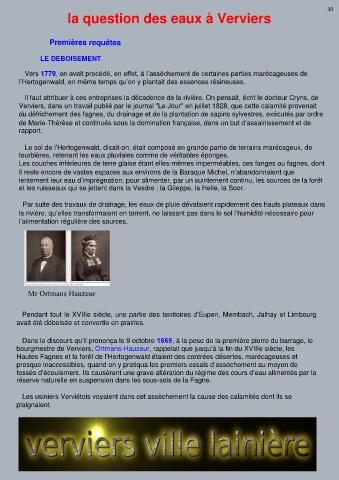Page 30 - le barrage de la gileppe
P. 30
30
la question des eaux à Verviers
Premières requêtes
LE DEBOISEMENT
Vers 1779, on avait procédé, en effet, à l’assèchement de certaines parties marécageuses de
l’Hertogenwald, en même temps qu’on y plantait des essences résineuses.
Il faut attribuer à ces entreprises la décadence de la rivière. On pensait, écrit le docteur Cryns, de
Verviers, dans un travail publié par le journal "Le Jour" en juillet 1828, que cette calamité provenait
du défrichement des fagnes, du drainage et de la plantation de sapins sylvestres, exécutés par ordre
de Marie-Thérèse et continués sous la domination française, dans un but d’assainissement et de
rapport.
Le sol de l’Hertogenwald, disait-on, était composé en grande partie de terrains marécageux, de
tourbières, retenant les eaux pluviales comme de véritables éponges.
Les couches inférieures de terre glaise étant elles-mêmes imperméables, ces fanges ou fagnes, dont
il reste encore de vastes espaces aux environs de la Baraque Michel, n’abandonnaient que
lentement leur eau d’imprégnation, pour alimenter, par un suintement continu, les sources de la forêt
et les ruisseaux qui se jettent dans la Vesdre : la Gileppe, la Helle, la Soor.
Par suite des travaux de drainage, les eaux de pluie dévalaient rapidement des hauts plateaux dans
la rivière, qu’elles transformaient en torrent, ne laissant pas dans le sol l’humidité nécessaire pour
l’alimentation régulière des sources.
Mr Ortmans Hauzeur
Pendant tout le XVIIIe siècle, une partie des territoires d'Eupen, Membach, Jalhay et Limbourg
avait été déboisée et convertie en prairies.
Dans le discours qu’il prononça le 9 octobre 1869, à la pose de la première pierre du barrage, le
bourgmestre de Verviers, Ortmans-Hauzeur, rappelait que jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les
Hautes Fagnes et la forêt de l’Hertogenwald étaient des contrées désertes, marécageuses et
presque inaccessibles, quand on y pratiqua les premiers essais d’assèchement au moyen de
fossés d’écoulement. Ils causèrent une grave altération du régime des cours d’eau alimentés par la
réserve naturelle en suspension dans les sous-sols de la Fagne.
Les usiniers Verviétois voyaient dans cet assèchement la cause des calamités dont ils se
plaignaient.