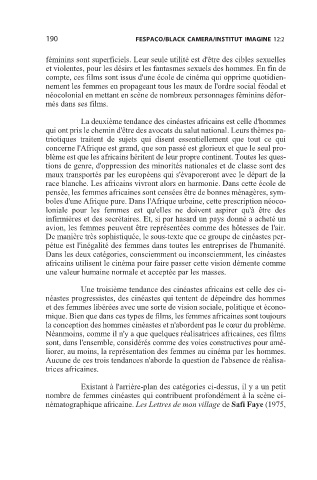Page 199 - Livre2_NC
P. 199
190 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
féminins sont superficiels. Leur seule utilité est d'être des cibles sexuelles
et violentes, pour les désirs et les fantasmes sexuels des hommes. En fin de
compte, ces films sont issus d'une école de cinéma qui opprime quotidien-
nement les femmes en propageant tous les maux de l'ordre social féodal et
néocolonial en mettant en scène de nombreux personnages féminins défor-
més dans ses films.
La deuxième tendance des cinéastes africains est celle d'hommes
qui ont pris le chemin d'être des avocats du salut national. Leurs thèmes pa-
triotiques traitent de sujets qui disent essentiellement que tout ce qui
concerne l'Afrique est grand, que son passé est glorieux et que le seul pro-
blème est que les africains héritent de leur propre continent. Toutes les ques-
tions de genre, d'oppression des minorités nationales et de classe sont des
maux transportés par les européens qui s'évaporeront avec le départ de la
race blanche. Les africains vivront alors en harmonie. Dans cette école de
pensée, les femmes africaines sont censées être de bonnes ménagères, sym-
boles d'une Afrique pure. Dans l'Afrique urbaine, cette prescription néoco-
loniale pour les femmes est qu'elles ne doivent aspirer qu'à être des
infirmières et des secrétaires. Et, si par hasard un pays donné a acheté un
avion, les femmes peuvent être représentées comme des hôtesses de l'air.
De manière très sophistiquée, le sous-texte que ce groupe de cinéastes per-
pétue est l'inégalité des femmes dans toutes les entreprises de l'humanité.
Dans les deux catégories, consciemment ou inconsciemment, les cinéastes
africains utilisent le cinéma pour faire passer cette vision démente comme
une valeur humaine normale et acceptée par les masses.
Une troisième tendance des cinéastes africains est celle des ci-
néastes progressistes, des cinéastes qui tentent de dépeindre des hommes
et des femmes libérées avec une sorte de vision sociale, politique et écono-
mique. Bien que dans ces types de films, les femmes africaines sont toujours
la conception des hommes cinéastes et n'abordent pas le cœur du problème.
Néanmoins, comme il n'y a que quelques réalisatrices africaines, ces films
sont, dans l'ensemble, considérés comme des voies constructives pour amé-
liorer, au moins, la représentation des femmes au cinéma par les hommes.
Aucune de ces trois tendances n'aborde la question de l'absence de réalisa-
trices africaines.
Existant à l'arrière-plan des catégories ci-dessus, il y a un petit
nombre de femmes cinéastes qui contribuent profondément à la scène ci-
nématographique africaine. Les Lettres de mon village de Safi Faye (1975,