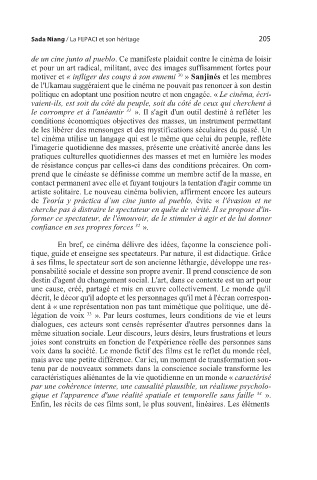Page 214 - Livre2_NC
P. 214
Sada Niang / La FEPACI et son héritage 205
de un cine junto al pueblo. Ce manifeste plaidait contre le cinéma de loisir
et pour un art radical, militant, avec des images suffisamment fortes pour
motiver et « infliger des coups à son ennemi » Sanjinés et les membres
30
de l'Ukamau suggéraient que le cinéma ne pouvait pas renoncer à son destin
politique en adoptant une position neutre et non engagée. « Le cinéma, écri-
vaient-ils, est soit du côté du peuple, soit du côté de ceux qui cherchent à
le corrompre et à l'anéantir 31 ». Il s'agit d'un outil destiné à refléter les
conditions économiques objectives des masses, un instrument permettant
de les libérer des mensonges et des mystifications séculaires du passé. Un
tel cinéma utilise un langage qui est le même que celui du peuple, reflète
l'imagerie quotidienne des masses, présente une créativité ancrée dans les
pratiques culturelles quotidiennes des masses et met en lumière les modes
de résistance conçus par celles-ci dans des conditions précaires. On com-
prend que le cinéaste se définisse comme un membre actif de la masse, en
contact permanent avec elle et fuyant toujours la tentation d'agir comme un
artiste solitaire. Le nouveau cinéma bolivien, affirment encore les auteurs
de Teoría y práctica d’un cine junto al pueblo, évite « l'évasion et ne
cherche pas à distraire le spectateur en quête de vérité. Il se propose d'in-
former ce spectateur, de l'émouvoir, de le stimuler à agir et de lui donner
confiance en ses propres forces ».
32
En bref, ce cinéma délivre des idées, façonne la conscience poli-
tique, guide et enseigne ses spectateurs. Par nature, il est didactique. Grâce
à ses films, le spectateur sort de son ancienne léthargie, développe une res-
ponsabilité sociale et dessine son propre avenir. Il prend conscience de son
destin d'agent du changement social. L'art, dans ce contexte est un art pour
une cause, créé, partagé et mis en œuvre collectivement. Le monde qu'il
décrit, le décor qu'il adopte et les personnages qu'il met à l'écran correspon-
dent à « une représentation non pas tant mimétique que politique, une dé-
légation de voix 33 ». Par leurs costumes, leurs conditions de vie et leurs
dialogues, ces acteurs sont censés représenter d'autres personnes dans la
même situation sociale. Leur discours, leurs désirs, leurs frustrations et leurs
joies sont construits en fonction de l'expérience réelle des personnes sans
voix dans la société. Le monde fictif des films est le reflet du monde réel,
mais avec une petite différence. Car ici, un moment de transformation sou-
tenu par de nouveaux sommets dans la conscience sociale transforme les
caractéristiques aliénantes de la vie quotidienne en un monde « caractérisé
par une cohérence interne, une causalité plausible, un réalisme psycholo-
gique et l'apparence d'une réalité spatiale et temporelle sans faille 34 ».
Enfin, les récits de ces films sont, le plus souvent, linéaires. Les éléments