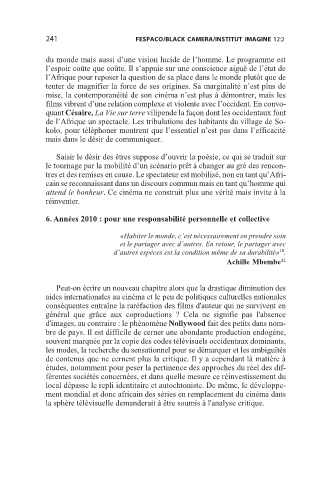Page 250 - Livre2_NC
P. 250
241 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
du monde mais aussi d’une vision lucide de l’homme. Le programme est
l’espoir coûte que coûte. Il s’appuie sur une conscience aiguë de l’état de
l’Afrique pour reposer la question de sa place dans le monde plutôt que de
tenter de magnifier la force de ses origines. Sa marginalité n’est plus de
mise, la contemporanéité de son cinéma n’est plus à démontrer, mais les
films vibrent d’une relation complexe et violente avec l’occident. En convo-
quant Césaire, La Vie sur terre vilipende la façon dont les occidentaux font
de l’Afrique un spectacle. Les tribulations des habitants du village de So-
kolo, pour téléphoner montrent que l’essentiel n’est pas dans l’efficacité
mais dans le désir de communiquer.
Saisir le désir des êtres suppose d’ouvrir la poésie, ce qui se traduit sur
le tournage par la mobilité d’un scénario prêt à changer au gré des rencon-
tres et des remises en cause. Le spectateur est mobilisé, non en tant qu’Afri-
cain se reconnaissant dans un discours commun mais en tant qu’homme qui
attend le bonheur. Ce cinéma ne construit plus une vérité mais invite à la
réinventer.
6. Années 2010 : pour une responsabilité personnelle et collective
«Habiter le monde, c’est nécessairement en prendre soin
et le partager avec d’autres. En retour, le partager avec
d’autres espèces est la condition même de sa durabilité» .
10
11
Achille Mbembe
Peut-on écrire un nouveau chapitre alors que la drastique diminution des
aides internationales au cinéma et le peu de politiques culturelles nationales
conséquentes entraîne la raréfaction des films d'auteur qui ne survivent en
général que grâce aux coproductions ? Cela ne signifie pas l'absence
d'images, au contraire : le phénomène Nollywood fait des petits dans nom-
bre de pays. Il est difficile de cerner une abondante production endogène,
souvent marquée par la copie des codes télévisuels occidentaux dominants,
les modes, la recherche du sensationnel pour se démarquer et les ambiguïtés
de contenus que ne cernent plus la critique. Il y a cependant là matière à
études, notamment pour peser la pertinence des approches du réel des dif-
férentes sociétés concernées, et dans quelle mesure ce réinvestissement du
local dépasse le repli identitaire et autochtoniste. De même, le développe-
ment mondial et donc africain des séries en remplacement du cinéma dans
la sphère télévisuelle demanderait à être soumis à l'analyse critique.