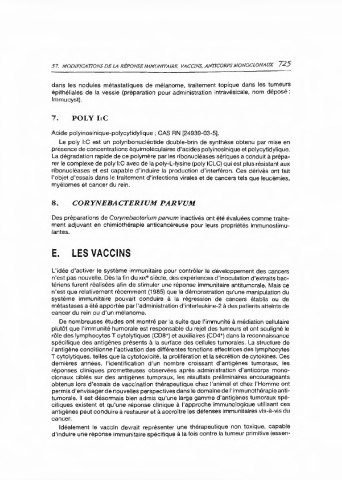Page 767 - Traité de chimie thérapeutique 6 Médicaments antitumoraux
P. 767
37. MODIFICATIONS DE LA REPONSE IMMUNITAIRE, VACCINS, ANTICORPS MONOCLONAUX 725
dans les nodules métastatiques de mélanome, traitement topique dans les tumeurs
épithéliales de la vessie (préparation pour administration intravésicale, nom déposé :
Immucyst).
7. POLY I:C
Acide polyinosinique-polycytidylique ; CAS RN [24939-03-5].
Le poly I:C est un polyribonucléotide double-brin de synthèse obtenu par mise en
présence de concentrations équimoléculaires d'acides polyinosinique et polycytidylique.
Ladégradation rapide de ce polymère par les ribonucléases sériques a conduit à prépa-
rer le complexe de poly l:C avec de la poly-L-lysine (poly ICLC) qui est plus résistant aux
ribonucléases et est capable d'induire la production d'interféron. Ces dérivés ont fait
l'objet d'essais dans le traitement d'infections virales et de cancers tels que leucémies,
myélomes et cancer du rein.
8. CORYNEBACTERIUM PARVUM
Des préparations de Corynebacterium parvum inactivés ont été évaluées comme traite-
ment adjuvant en chimiothérapie anticancéreuse pour leurs propriétés immunostimu-
lantes.
E. LES VACCINS
L'idée d'activer le système immunitaire pour contrôler le développement des cancers
n'est pas nouvelle. Dès la fin du xpx? siècle, des expériences d'inoculation d'extraits bac-
tériens furent réalisées afin de stimuler une réponse immunitaire antitumorale. Mais ce
n'est que relativement récemment (1985) que la démonstration qu'une manipulation du
système immunitaire pouvait conduire à la régression de cancers établis ou de
métastases a été apportée par l'administration d'interleukine-2 à des patients atteints de
cancer du rein ou d'un mélanome.
De nombreuses études ont montré par la suite que l'immunité à médiation cellulaire
plutôt que l'immunité humorale est responsable du rejet des tumeurs et ont souligné le
rôle des lymphocytes T cytolytiques (CD8) et auxiliaires (CD4) dans la reconnaissance
spécifique des antigènes présents à la surface des cellules tumorales. La structure de
l'antigène conditionne l'activation des différentes fonctions effectrices des lymphocytes
T cytolytiques, telles que la cytotoxicité, la prolifération et la sécrétion de cytokines. Ces
dernières années, l'identification d'un nombre croissant d'antigènes tumoraux, les
réponses cliniques prometteuses observées après administration d'anticorps mono-
clonaux ciblés sur des antigènes tumoraux, les résultats préliminaires encourageants
obtenus lors d'essais de vaccination thérapeutique chez l'animal et chez l'Homme ont
permis d'envisagerde nouvelles perspectives dans le domaine de l'immunothérapie anti-
tumorale. Il est désormais bien admis qu'une large gamme d'antigènes tumoraux spé-
cifiques existent et qu'une réponse clinique à l'approche immunologique utilisant ces
antigènes peut conduire à restaurer et à accroître les défenses immunitaires vis-à-vis du
cancer.
Idéalement le vaccin devrait représenter une thérapeutique non toxique, capable
d'induire une réponse immunitaire spécifique à la fois contre la tumeur primitive (essen-