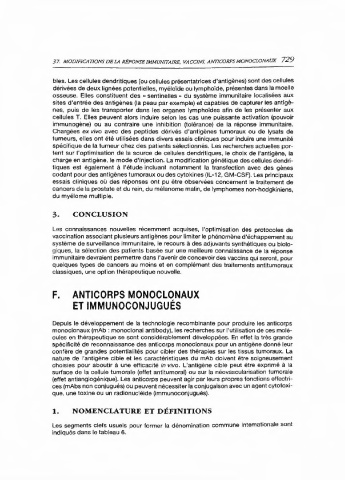Page 771 - Traité de chimie thérapeutique 6 Médicaments antitumoraux
P. 771
37. MODIFICATIONS DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE, VACCINS, ANTI CORPS MONOCLONAUX 729
bles. Les cellules dendritiques (ou cellules présentatrices d'antigènes) sont des cellules
dérivées de deux lignées potentielles, myéloide ou lymphoïde, présentes dans la moelle
osseuse. Elles constituent des « sentinelles » du système immunitaire localisées aux
sites d'entrée des antigènes (la peau par exemple) et capables de capturer les antigè-
nes, puis de les transporter dans les organes lymphoïdes afin de les présenter aux
cellules T. Elles peuvent alors induire selon les cas une puissante activation (pouvoir
immunogène) ou au contraire une inhibition (tolérance) de la réponse immunitaire.
Chargées ex vivo avec des peptides dérivés d'antigènes tumoraux ou de lysats de
tumeurs, elles ont été utilisées dans divers essais cliniques pour induire une immunité
spécifique de la tumeur chez des patients sélectionnés. Les recherches actuelles por-
tent sur l'optimisation de la source de cellules dendritiques, le choix de l'antigène, la
charge en antigène, le mode d'injection. La modification génétique des cellules dendri-
tiques est également à l'étude incluant notamment la transfection avec des gènes
codant pour des antigènes tumoraux ou des cytokines (IL-12, GM-CSF). Les principaux
essais cliniques où des réponses ont pu être observées concernent le traitement de
cancers de la prostate et du rein, du mélanome malin, de lymphomes non-hodgkiniens,
du myélome multiple.
3. CONCLUSION
Les connaissances nouvelles récemment acquises, l'optimisation des protocoles de
vaccination associant plusieurs antigènes pour limiter le phénomène d'échappement au
système de surveillance immunitaire, le recours à des adjuvants synthétiques ou biolo-
giques, la sélection des patients basée sur une meilleure connaissance de la réponse
immunitaire devraient permettre dans l'avenir de concevoir des vaccins qui seront, pour
quelques types de cancers au moins et en complément des traitements antitumoraux
classiques, une option thérapeutique nouvelle.
F. ANTICORPS MONOCLONAUX
ET IMMUNOCONJUGUÉS
Depuis le développement de la technologie recombinante pour produire les anticorps
monoclonaux (mAb : monoclonal antibody), les recherches sur l'utilisation de ces molé-
cules en thérapeutique se sont considérablement développées. En effet la très grande
spécificité de reconnaissance des anticorps monoclonaux pour un antigène donné leur
confère de grandes potentialités pour cibler des thérapies sur les tissus tumoraux. La
nature de l'antigène cible et les caractéristiques du mAb doivent être soigneusement
choisies pour aboutir à une efficacité in vivo. L'antigène cible peut être exprimé à la
surface de la cellule tumorale (effet antitumoral) ou sur la néovascularisation tumorale
(effet antiangiogénique). Les anticorps peuvent agir par leurs propres fonctions effectri-
ces (mAbs non conjugués) ou peuvent nécessiter la conjugaison avec un agent cytotoxi-
que, une toxine ou un radionucléide (immunoconjugués).
1. NOMENCLATURE ET DÉFINITIONS
Les segments clefs usuels pour former la dénomination commune internationale sont
indiqués dans le tableau 6.