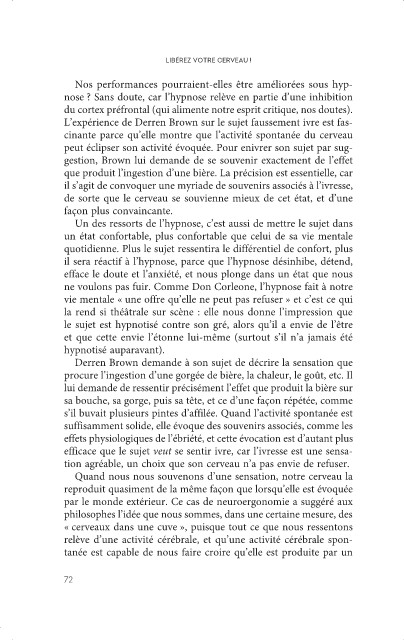Page 73 - 266687ILJ_CERVEAU_cs6_pc.indd
P. 73
LIBÉREZ VOTRE CERVEAU !
Nos performances pourraient‑ elles être améliorées sous hyp‑
nose ? Sans doute, car l’hypnose relève en partie d’une inhibition
du cortex préfrontal (qui alimente notre esprit critique, nos doutes).
L’expérience de Derren Brown sur le sujet faussement ivre est fas‑
cinante parce qu’elle montre que l’activité spontanée du cerveau
peut éclipser son activité évoquée. Pour enivrer son sujet par sug‑
gestion, Brown lui demande de se souvenir exactement de l’effet
que produit l’ingestion d’une bière. La précision est essentielle, car
il s’agit de convoquer une myriade de souvenirs associés à l’ivresse,
de sorte que le cerveau se souvienne mieux de cet état, et d’une
façon plus convaincante.
Un des ressorts de l’hypnose, c’est aussi de mettre le sujet dans
un état confortable, plus confortable que celui de sa vie mentale
quotidienne. Plus le sujet ressentira le différentiel de confort, plus
il sera réactif à l’hypnose, parce que l’hypnose désinhibe, détend,
efface le doute et l’anxiété, et nous plonge dans un état que nous
ne voulons pas fuir. Comme Don Corleone, l’hypnose fait à notre
vie mentale « une offre qu’elle ne peut pas refuser » et c’est ce qui
la rend si théâtrale sur scène : elle nous donne l’impression que
le sujet est hypnotisé contre son gré, alors qu’il a envie de l’être
et que cette envie l’étonne lui‑ même (surtout s’il n’a jamais été
hypnotisé auparavant).
Derren Brown demande à son sujet de décrire la sensation que
procure l’ingestion d’une gorgée de bière, la chaleur, le goût, etc. Il
lui demande de ressentir précisément l’effet que produit la bière sur
sa bouche, sa gorge, puis sa tête, et ce d’une façon répétée, comme
s’il buvait plusieurs pintes d’affilée. Quand l’activité spontanée est
suffisamment solide, elle évoque des souvenirs associés, comme les
effets physiologiques de l’ébriété, et cette évocation est d’autant plus
efficace que le sujet veut se sentir ivre, car l’ivresse est une sensa‑
tion agréable, un choix que son cerveau n’a pas envie de refuser.
Quand nous nous souvenons d’une sensation, notre cerveau la
reproduit quasiment de la même façon que lorsqu’elle est évoquée
par le monde extérieur. Ce cas de neuroergonomie a suggéré aux
philosophes l’idée que nous sommes, dans une certaine mesure, des
« cerveaux dans une cuve », puisque tout ce que nous ressentons
relève d’une activité cérébrale, et qu’une activité cérébrale spon‑
tanée est capable de nous faire croire qu’elle est produite par un
72
266687ILJ_CERVEAU_cs6_pc.indd 72 02/09/2016 14:38:58