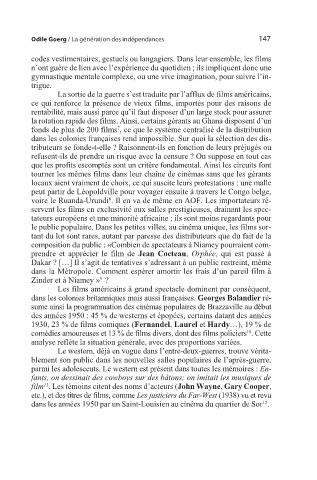Page 156 - Livre2_NC
P. 156
Odile Goerg / La génération des indépendances 147
codes vestimentaires, gestuels ou langagiers. Dans leur ensemble, les films
n’ont guère de lien avec l’expérience du quotidien ; ils impliquent donc une
gymnastique mentale complexe, ou une vive imagination, pour suivre l’in-
trigue.
La sortie de la guerre s’est traduite par l’afflux de films américains,
ce qui renforce la présence de vieux films, importés pour des raisons de
rentabilité, mais aussi parce qu’il faut disposer d’un large stock pour assurer
la rotation rapide des films. Ainsi, certains gérants au Ghana disposent d’un
fonds de plus de 200 films , ce que le système centralisé de la distribution
7
dans les colonies françaises rend impossible. Sur quoi la sélection des dis-
tributeurs se fonde-t-elle ? Raisonnent-ils en fonction de leurs préjugés ou
refusent-ils de prendre un risque avec la censure ? On suppose en tout cas
que les profits escomptés sont un critère fondamental. Ainsi les circuits font
tourner les mêmes films dans leur chaîne de cinémas sans que les gérants
locaux aient vraiment de choix, ce qui suscite leurs protestations : une malle
peut partir de Léopoldville pour voyager ensuite à travers le Congo belge,
voire le Ruanda-Urundi . Il en va de même en AOF. Les importateurs ré-
8
servent les films en exclusivité aux salles prestigieuses, drainant les spec-
tateurs européens et une minorité africaine ; ils sont moins regardants pour
le public populaire. Dans les petites villes, au cinéma unique, les films sor-
tant du lot sont rares, autant par paresse des distributeurs que du fait de la
composition du public : «Combien de spectateurs à Niamey pourraient com-
prendre et apprécier le film de Jean Cocteau, Orphée, qui est passé à
Dakar ? […] Il s’agit de tentatives s’adressant à un public restreint, même
dans la Métropole. Comment espérer amortir les frais d’un pareil film à
Zinder et à Niamey » ?
9
Les films américains à grand spectacle dominent par conséquent,
dans les colonies britanniques mais aussi françaises. Georges Balandier ré-
sume ainsi la programmation des cinémas populaires de Brazzaville au début
des années 1950 : 45 % de westerns et épopées, certains datant des années
1930, 23 % de films comiques (Fernandel, Laurel et Hardy…), 19 % de
comédies amoureuses et 13 % de films divers, dont des films policiers . Cette
10
analyse reflète la situation générale, avec des proportions variées.
Le western, déjà en vogue dans l’entre-deux-guerres, trouve vérita-
blement son public dans les nouvelles salles populaires de l’après-guerre,
parmi les adolescents. Le western est présent dans toutes les mémoires : En-
fants, on dessinait des cowboys sur des bâtons; on imitait les musiques de
film . Les témoins citent des noms d’acteurs (John Wayne, Gary Cooper,
11
etc.), et des titres de films, comme Les justiciers du Far-West (1938) vu et revu
dans les années 1950 par un Saint-Louisien au cinéma du quartier de Sor .
12