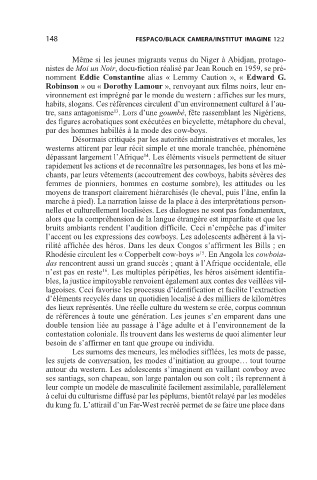Page 157 - Livre2_NC
P. 157
148 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
Même si les jeunes migrants venus du Niger à Abidjan, protago-
nistes de Moi un Noir, docu-fiction réalisé par Jean Rouch en 1959, se pré-
nomment Eddie Constantine alias « Lemmy Caution », « Edward G.
Robinson » ou « Dorothy Lamour », renvoyant aux films noirs, leur en-
vironnement est imprégné par le monde du western : affiches sur les murs,
habits, slogans. Ces références circulent d’un environnement culturel à l’au-
tre, sans antagonisme . Lors d’une goumbé, fête rassemblant les Nigériens,
13
des figures acrobatiques sont exécutées en bicyclette, métaphore du cheval,
par des hommes habillés à la mode des cow-boys.
Désormais critiqués par les autorités administratives et morales, les
westerns attirent par leur récit simple et une morale tranchée, phénomène
dépassant largement l’Afrique . Les éléments visuels permettent de situer
14
rapidement les actions et de reconnaître les personnages, les bons et les mé-
chants, par leurs vêtements (accoutrement des cowboys, habits sévères des
femmes de pionniers, hommes en costume sombre), les attitudes ou les
moyens de transport clairement hiérarchisés (le cheval, puis l’âne, enfin la
marche à pied). La narration laisse de la place à des interprétations person-
nelles et culturellement localisées. Les dialogues ne sont pas fondamentaux,
alors que la compréhension de la langue étrangère est imparfaite et que les
bruits ambiants rendent l’audition difficile. Ceci n’empêche pas d’imiter
l’accent ou les expressions des cowboys. Les adolescents adhèrent à la vi-
rilité affichée des héros. Dans les deux Congos s’affirment les Bills ; en
Rhodésie circulent les « Copperbelt cow-boys » . En Angola les cowboia-
15
das rencontrent aussi un grand succès ; quant à l’Afrique occidentale, elle
n’est pas en reste . Les multiples péripéties, les héros aisément identifia-
16
bles, la justice impitoyable renvoient également aux contes des veillées vil-
lageoises. Ceci favorise les processus d’identification et facilite l’extraction
d’éléments recyclés dans un quotidien localisé à des milliers de kilomètres
des lieux représentés. Une réelle culture du western se crée, corpus commun
de références à toute une génération. Les jeunes s’en emparent dans une
double tension liée au passage à l’âge adulte et à l’environnement de la
contestation coloniale. Ils trouvent dans les westerns de quoi alimenter leur
besoin de s’affirmer en tant que groupe ou individu.
Les surnoms des meneurs, les mélodies sifflées, les mots de passe,
les sujets de conversation, les modes d’initiation au groupe… tout tourne
autour du western. Les adolescents s’imaginent en vaillant cowboy avec
ses santiags, son chapeau, son large pantalon ou son colt ; ils reprennent à
leur compte un modèle de masculinité facilement assimilable, parallèlement
à celui du culturisme diffusé par les péplums, bientôt relayé par les modèles
du kung fu. L’attirail d’un Far-West recréé permet de se faire une place dans