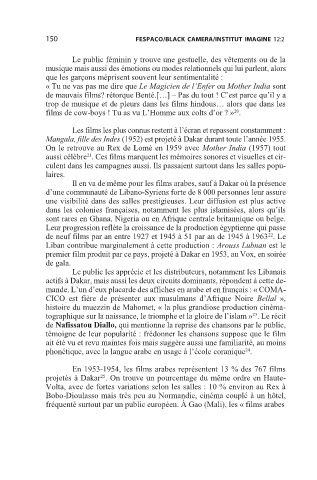Page 159 - Livre2_NC
P. 159
150 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
Le public féminin y trouve une gestuelle, des vêtements ou de la
musique mais aussi des émotions ou modes relationnels qui lui parlent, alors
que les garçons méprisent souvent leur sentimentalité :
« Tu ne vas pas me dire que Le Magicien de l’Enfer ou Mother India sont
de mauvais films? rétorque Benté.[…] – Pas du tout ! C’est parce qu’il y a
trop de musique et de pleurs dans les films hindous… alors que dans les
films de cow-boys ! Tu as vu L’Homme aux colts d’or ? » .
20
Les films les plus connus restent à l’écran et repassent constamment :
Mangala, fille des Indes (1952) est projeté à Dakar durant toute l’année 1955.
On le retrouve au Rex de Lomé en 1959 avec Mother India (1957) tout
aussi célèbre . Ces films marquent les mémoires sonores et visuelles et cir-
21
culent dans les campagnes aussi. Ils passaient surtout dans les salles popu-
laires.
Il en va de même pour les films arabes, sauf à Dakar où la présence
d’une communauté de Libano-Syriens forte de 8 000 personnes leur assure
une visibilité dans des salles prestigieuses. Leur diffusion est plus active
dans les colonies françaises, notamment les plus islamisées, alors qu’ils
sont rares en Ghana, Nigeria ou en Afrique centrale britannique ou belge.
Leur progression reflète la croissance de la production égyptienne qui passe
de neuf films par an entre 1927 et 1945 à 51 par an de 1945 à 1963 . Le
22
Liban contribue marginalement à cette production : Arouss Lubnan est le
premier film produit par ce pays, projeté à Dakar en 1953, au Vox, en soirée
de gala.
Le public les apprécie et les distributeurs, notamment les Libanais
actifs à Dakar, mais aussi les deux circuits dominants, répondent à cette de-
mande. L’un d’eux placarde des affiches en arabe et en français : « COMA-
CICO est fière de présenter aux musulmans d’Afrique Noire Bellal »,
histoire du muezzin de Mahomet, « la plus grandiose production cinéma-
tographique sur la naissance, le triomphe et la gloire de l’islam » . Le récit
23
de Nafissatou Diallo, qui mentionne la reprise des chansons par le public,
témoigne de leur popularité : frédonner les chansons suppose que le film
ait été vu et revu maintes fois mais suggère aussi une familiarité, au moins
phonétique, avec la langue arabe en usage à l’école coranique .
24
En 1953-1954, les films arabes représentent 13 % des 767 films
projetés à Dakar . On trouve un pourcentage du même ordre en Haute-
25
Volta, avec de fortes variations selon les salles : 10 % environ au Rex à
Bobo-Dioulasso mais très peu au Normandie, cinéma couplé à un hôtel,
fréquenté surtout par un public européen. À Gao (Mali), les « films arabes