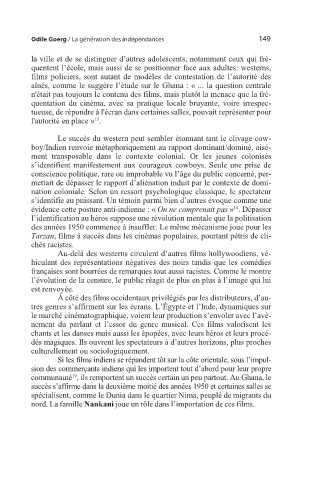Page 158 - Livre2_NC
P. 158
Odile Goerg / La génération des indépendances 149
la ville et de se distinguer d’autres adolescents, notamment ceux qui fré-
quentent l’école, mais aussi de se positionner face aux adultes: westerns,
films policiers, sont autant de modèles de contestation de l’autorité des
aînés, comme le suggère l’étude sur le Ghana : « ... la question centrale
n'était pas toujours le contenu des films, mais plutôt la menace que la fré-
quentation du cinéma, avec sa pratique locale bruyante, voire irrespec-
tueuse, de répondre à l'écran dans certaines salles, pouvait représenter pour
l'autorité en place » .
17
Le succès du western peut sembler étonnant tant le clivage cow-
boy/Indien renvoie métaphoriquement au rapport dominant/dominé, aisé-
ment transposable dans le contexte colonial. Or les jeunes colonisés
s’identifient manifestement aux courageux cowboys. Seule une prise de
conscience politique, rare ou improbable vu l’âge du public concerné, per-
mettait de dépasser le rapport d’aliénation induit par le contexte de domi-
nation coloniale. Selon un ressort psychologique classique, le spectateur
s’identifie au puissant. Un témoin parmi bien d’autres évoque comme une
évidence cette posture anti-indienne : « On ne comprenait pas » . Dépasser
18
l’identification au héros suppose une révolution mentale que la politisation
des années 1950 commence à insuffler. Le même mécanisme joue pour les
Tarzan, films à succès dans les cinémas populaires, pourtant pétris de cli-
chés racistes.
Au-delà des westerns circulent d’autres films hollywoodiens, vé-
hiculant des représentations négatives des noirs tandis que les comédies
françaises sont bourrées de remarques tout aussi racistes. Comme le montre
l’évolution de la censure, le public réagit de plus en plus à l’image qui lui
est renvoyée.
À côté des films occidentaux privilégiés par les distributeurs, d’au-
tres genres s’affirment sur les écrans. L’Égypte et l’Inde, dynamiques sur
le marché cinématographique, voient leur production s’envoler avec l’avè-
nement du parlant et l’essor du genre musical. Ces films valorisent les
chants et les danses mais aussi les épopées, avec leurs héros et leurs procé-
dés magiques. Ils ouvrent les spectateurs à d’autres horizons, plus proches
culturellement ou sociologiquement.
Si les films indiens se répandent tôt sur la côte orientale, sous l’impul-
sion des commerçants indiens qui les importent tout d’abord pour leur propre
communauté , ils remportent un succès certain un peu partout. Au Ghana, le
19
succès s’affirme dans la deuxième moitié des années 1950 et certaines salles se
spécialisent, comme le Dunia dans le quartier Nima, peuplé de migrants du
nord. La famille Nankani joue un rôle dans l’importation de ces films.