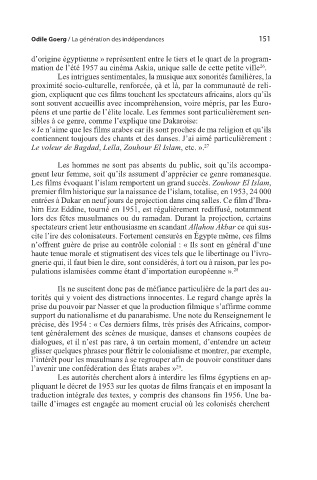Page 160 - Livre2_NC
P. 160
Odile Goerg / La génération des indépendances 151
d’origine égyptienne » représentent entre le tiers et le quart de la program-
mation de l’été 1957 au cinéma Askia, unique salle de cette petite ville .
26
Les intrigues sentimentales, la musique aux sonorités familières, la
proximité socio-culturelle, renforcée, çà et là, par la communauté de reli-
gion, expliquent que ces films touchent les spectateurs africains, alors qu’ils
sont souvent accueillis avec incompréhension, voire mépris, par les Euro-
péens et une partie de l’élite locale. Les femmes sont particulièrement sen-
sibles à ce genre, comme l’explique une Dakaroise:
« Je n’aime que les films arabes car ils sont proches de ma religion et qu’ils
contiennent toujours des chants et des danses. J’ai aimé particulièrement :
Le voleur de Bagdad, Leïla, Zouhour El Islam, etc. ». 27
Les hommes ne sont pas absents du public, soit qu’ils accompa-
gnent leur femme, soit qu’ils assument d’apprécier ce genre romanesque.
Les films évoquant l’islam remportent un grand succès. Zouhour El Islam,
premier film historique sur la naissance de l’islam, totalise, en 1953, 24 000
entrées à Dakar en neuf jours de projection dans cinq salles. Ce film d’Ibra-
him Ezz Eddine, tourné en 1951, est régulièrement rediffusé, notamment
lors des fêtes musulmanes ou du ramadan. Durant la projection, certains
spectateurs crient leur enthousiasme en scandant Allahou Akbar ce qui sus-
cite l’ire des colonisateurs. Fortement censurés en Égypte même, ces films
n’offrent guère de prise au contrôle colonial : « Ils sont en général d’une
haute tenue morale et stigmatisent des vices tels que le libertinage ou l’ivro-
gnerie qui, il faut bien le dire, sont considérés, à tort ou à raison, par les po-
28
pulations islamisées comme étant d’importation européenne ».
Ils ne suscitent donc pas de méfiance particulière de la part des au-
torités qui y voient des distractions innocentes. Le regard change après la
prise du pouvoir par Nasser et que la production filmique s’affirme comme
support du nationalisme et du panarabisme. Une note du Renseignement le
précise, dès 1954 : « Ces derniers films, très prisés des Africains, compor-
tent généralement des scènes de musique, danses et chansons coupées de
dialogues, et il n’est pas rare, à un certain moment, d’entendre un acteur
glisser quelques phrases pour flétrir le colonialisme et montrer, par exemple,
l’intérêt pour les musulmans à se regrouper afin de pouvoir constituer dans
l’avenir une confédération des États arabes » .
29
Les autorités cherchent alors à interdire les films égyptiens en ap-
pliquant le décret de 1953 sur les quotas de films français et en imposant la
traduction intégrale des textes, y compris des chansons fin 1956. Une ba-
taille d’images est engagée au moment crucial où les colonisés cherchent