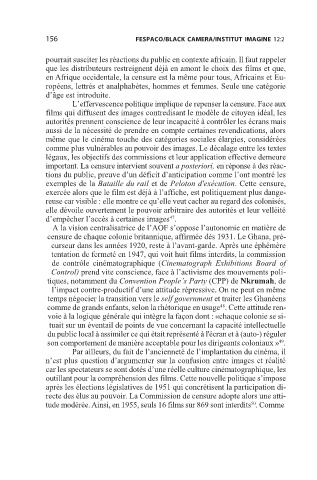Page 165 - Livre2_NC
P. 165
156 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
pourrait susciter les réactions du public en contexte africain. Il faut rappeler
que les distributeurs restreignent déjà en amont le choix des films et que,
en Afrique occidentale, la censure est la même pour tous, Africains et Eu-
ropéens, lettrés et analphabètes, hommes et femmes. Seule une catégorie
d’âge est introduite.
L’effervescence politique implique de repenser la censure. Face aux
films qui diffusent des images contredisant le modèle de citoyen idéal, les
autorités prennent conscience de leur incapacité à contrôler les écrans mais
aussi de la nécessité de prendre en compte certaines revendications, alors
même que le cinéma touche des catégories sociales élargies, considérées
comme plus vulnérables au pouvoir des images. Le décalage entre les textes
légaux, les objectifs des commissions et leur application effective demeure
important. La censure intervient souvent a posteriori, en réponse à des réac-
tions du public, preuve d’un déficit d’anticipation comme l’ont montré les
exemples de la Bataille du rail et de Peloton d'exécution. Cette censure,
exercée alors que le film est déjà à l’affiche, est politiquement plus dange-
reuse car visible : elle montre ce qu’elle veut cacher au regard des colonisés,
elle dévoile ouvertement le pouvoir arbitraire des autorités et leur velléité
d’empêcher l’accès à certaines images .
47
A la vision centralisatrice de l’AOF s’oppose l’autonomie en matière de
censure de chaque colonie britannique, affirmée dès 1931. Le Ghana, pré-
curseur dans les années 1920, reste à l’avant-garde. Après une éphémère
tentation de fermeté en 1947, qui voit huit films interdits, la commission
de contrôle cinématographique (Cinematograph Exhibitions Board of
Control) prend vite conscience, face à l’activisme des mouvements poli-
tiques, notamment du Convention People’s Party (CPP) de Nkrumah, de
l’impact contre-productif d’une attitude répressive. On ne peut en même
temps négocier la transition vers le self government et traiter les Ghanéens
comme de grands enfants, selon la rhétorique en usage . Cette attitude ren-
48
voie à la logique générale qui intègre la façon dont : «chaque colonie se si-
tuait sur un éventail de points de vue concernant la capacité intellectuelle
du public local à assimiler ce qui était représenté à l'écran et à (auto-) réguler
son comportement de manière acceptable pour les dirigeants coloniaux » .
49
Par ailleurs, du fait de l’ancienneté de l’implantation du cinéma, il
n’est plus question d’argumenter sur la confusion entre images et réalité
car les spectateurs se sont dotés d’une réelle culture cinématographique, les
outillant pour la compréhension des films. Cette nouvelle politique s’impose
après les élections législatives de 1951 qui concrétisent la participation di-
recte des élus au pouvoir. La Commission de censure adopte alors une atti-
tude modérée. Ainsi, en 1955, seuls 16 films sur 869 sont interdits . Comme
50