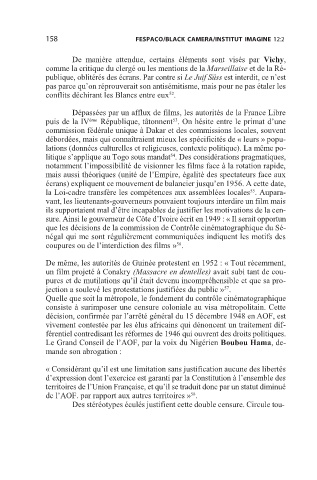Page 167 - Livre2_NC
P. 167
158 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
De manière attendue, certains éléments sont visés par Vichy,
comme la critique du clergé ou les mentions de la Marseillaise et de la Ré-
publique, oblitérés des écrans. Par contre si Le Juif Süss est interdit, ce n’est
pas parce qu’on réprouverait son antisémitisme, mais pour ne pas étaler les
conflits déchirant les Blancs entre eux .
52
Dépassées par un afflux de films, les autorités de la France Libre
puis de la IV ème République, tâtonnent . On hésite entre le primat d’une
53
commission fédérale unique à Dakar et des commissions locales, souvent
débordées, mais qui connaîtraient mieux les spécificités de « leurs » popu-
lations (données culturelles et religieuses, contexte politique). La même po-
litique s’applique au Togo sous mandat . Des considérations pragmatiques,
54
notamment l’impossibilité de visionner les films face à la rotation rapide,
mais aussi théoriques (unité de l’Empire, égalité des spectateurs face aux
écrans) expliquent ce mouvement de balancier jusqu’en 1956. A cette date,
la Loi-cadre transfère les compétences aux assemblées locales . Aupara-
55
vant, les lieutenants-gouverneurs pouvaient toujours interdire un film mais
ils supportaient mal d’être incapables de justifier les motivations de la cen-
sure. Ainsi le gouverneur de Côte d’Ivoire écrit en 1949 : « Il serait opportun
que les décisions de la commission de Contrôle cinématographique du Sé-
négal qui me sont régulièrement communiquées indiquent les motifs des
coupures ou de l’interdiction des films » .
56
De même, les autorités de Guinée protestent en 1952 : « Tout récemment,
un film projeté à Conakry (Massacre en dentelles) avait subi tant de cou-
pures et de mutilations qu’il était devenu incompréhensible et que sa pro-
jection a soulevé les protestations justifiées du public » .
57
Quelle que soit la métropole, le fondement du contrôle cinématographique
consiste à surimposer une censure coloniale au visa métropolitain. Cette
décision, confirmée par l’arrêté général du 15 décembre 1948 en AOF, est
vivement contestée par les élus africains qui dénoncent un traitement dif-
férentiel contredisant les réformes de 1946 qui ouvrent des droits politiques.
Le Grand Conseil de l’AOF, par la voix du Nigérien Boubou Hama, de-
mande son abrogation :
« Considérant qu’il est une limitation sans justification aucune des libertés
d’expression dont l’exercice est garanti par la Constitution à l’ensemble des
territoires de l’Union Française, et qu’il se traduit donc par un statut diminué
de l’AOF. par rapport aux autres territoires » .
58
Des stéréotypes éculés justifient cette double censure. Circule tou-