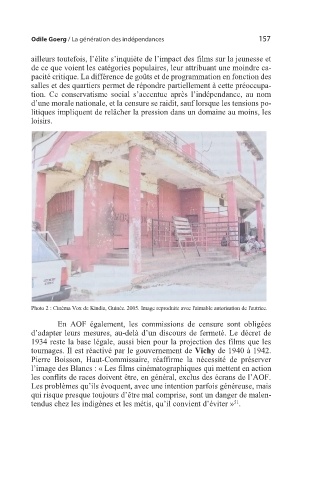Page 166 - Livre2_NC
P. 166
Odile Goerg / La génération des indépendances 157
ailleurs toutefois, l’élite s’inquiète de l’impact des films sur la jeunesse et
de ce que voient les catégories populaires, leur attribuant une moindre ca-
pacité critique. La différence de goûts et de programmation en fonction des
salles et des quartiers permet de répondre partiellement à cette préoccupa-
tion. Ce conservatisme social s’accentue après l’indépendance, au nom
d’une morale nationale, et la censure se raidit, sauf lorsque les tensions po-
litiques impliquent de relâcher la pression dans un domaine au moins, les
loisirs.
Photo 2 : Cinéma Vox de Kindia, Guinée. 2005. Image reproduite avec l'aimable autorisation de l'autrice.
En AOF également, les commissions de censure sont obligées
d’adapter leurs mesures, au-delà d’un discours de fermeté. Le décret de
1934 reste la base légale, aussi bien pour la projection des films que les
tournages. Il est réactivé par le gouvernement de Vichy de 1940 à 1942.
Pierre Boisson, Haut-Commissaire, réaffirme la nécessité de préserver
l’image des Blancs : « Les films cinématographiques qui mettent en action
les conflits de races doivent être, en général, exclus des écrans de l’AOF.
Les problèmes qu’ils évoquent, avec une intention parfois généreuse, mais
qui risque presque toujours d’être mal comprise, sont un danger de malen-
tendus chez les indigènes et les métis, qu’il convient d’éviter » .
51