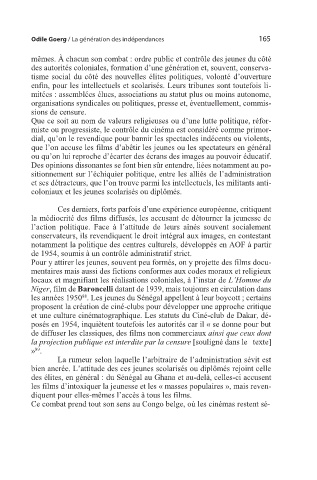Page 174 - Livre2_NC
P. 174
Odile Goerg / La génération des indépendances 165
mêmes. À chacun son combat : ordre public et contrôle des jeunes du côté
des autorités coloniales, formation d’une génération et, souvent, conserva-
tisme social du côté des nouvelles élites politiques, volonté d’ouverture
enfin, pour les intellectuels et scolarisés. Leurs tribunes sont toutefois li-
mitées : assemblées élues, associations au statut plus ou moins autonome,
organisations syndicales ou politiques, presse et, éventuellement, commis-
sions de censure.
Que ce soit au nom de valeurs religieuses ou d’une lutte politique, réfor-
miste ou progressiste, le contrôle du cinéma est considéré comme primor-
dial, qu’on le revendique pour bannir les spectacles indécents ou violents,
que l’on accuse les films d’abêtir les jeunes ou les spectateurs en général
ou qu’on lui reproche d’écarter des écrans des images au pouvoir éducatif.
Des opinions dissonantes se font bien sûr entendre, liées notamment au po-
sitionnement sur l’échiquier politique, entre les alliés de l’administration
et ses détracteurs, que l’on trouve parmi les intellectuels, les militants anti-
coloniaux et les jeunes scolarisés ou diplômés.
Ces derniers, forts parfois d’une expérience européenne, critiquent
la médiocrité des films diffusés, les accusant de détourner la jeunesse de
l’action politique. Face à l’attitude de leurs aînés souvent socialement
conservateurs, ils revendiquent le droit intégral aux images, en contestant
notamment la politique des centres culturels, développés en AOF à partir
de 1954, soumis à un contrôle administratif strict.
Pour y attirer les jeunes, souvent peu formés, on y projette des films docu-
mentaires mais aussi des fictions conformes aux codes moraux et religieux
locaux et magnifiant les réalisations coloniales, à l’instar de L’Homme du
Niger, film de Baroncelli datant de 1939, mais toujours en circulation dans
les années 1950 . Les jeunes du Sénégal appellent à leur boycott ; certains
88
proposent la création de ciné-clubs pour développer une approche critique
et une culture cinématographique. Les statuts du Ciné-club de Dakar, dé-
posés en 1954, inquiètent toutefois les autorités car il « se donne pour but
de diffuser les classiques, des films non commerciaux ainsi que ceux dont
la projection publique est interdite par la censure [souligné dans le texte]
» .
89
La rumeur selon laquelle l’arbitraire de l’administration sévit est
bien ancrée. L’attitude des ces jeunes scolarisés ou diplômés rejoint celle
des élites, en général : du Sénégal au Ghana et au-delà, celles-ci accusent
les films d’intoxiquer la jeunesse et les « masses populaires », mais reven-
diquent pour elles-mêmes l’accès à tous les films.
Ce combat prend tout son sens au Congo belge, où les cinémas restent sé-