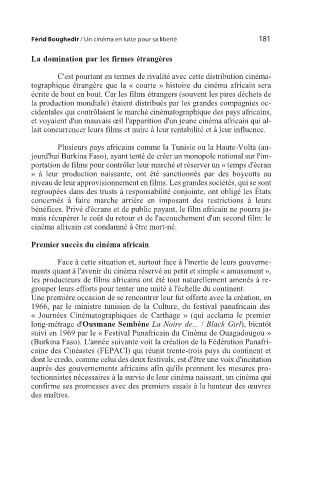Page 190 - Livre2_NC
P. 190
Férid Boughedir / Un cinéma en lutte pour sa liberté 181
La domination par les firmes étrangères
C'est pourtant en termes de rivalité avec cette distribution cinéma-
tographique étrangère que la « courte » histoire du cinéma africain sera
écrite de bout en bout. Car les films étrangers (souvent les pires déchets de
la production mondiale) étaient distribués par les grandes compagnies oc-
cidentales qui contrôlaient le marché cinématographique des pays africains,
et voyaient d'un mauvais œil l'apparition d'un jeune cinéma africain qui al-
lait concurrencer leurs films et nuire à leur rentabilité et à leur influence.
Plusieurs pays africains comme la Tunisie ou la Haute-Volta (au-
jourd'hui Burkina Faso), ayant tenté de créer un monopole national sur l'im-
portation de films pour contrôler leur marché et réserver un « temps d'écran
» à leur production naissante, ont été sanctionnés par des boycotts au
niveau de leur approvisionnement en films. Les grandes sociétés, qui se sont
regroupées dans des trusts à responsabilité conjointe, ont obligé les États
concernés à faire marche arrière en imposant des restrictions à leurs
bénéfices. Privé d'écrans et de public payant, le film africain ne pourra ja-
mais récupérer le coût du retour et de l'accouchement d'un second film: le
cinéma africain est condamné à être mort-né.
Premier succès du cinéma africain
Face à cette situation et, surtout face à l'inertie de leurs gouverne-
ments quant à l'avenir du cinéma réservé au petit et simple « amusement »,
les producteurs de films africains ont été tout naturellement amenés à re-
grouper leurs efforts pour tenter une unité à l'échelle du continent.
Une première occasion de se rencontrer leur fut offerte avec la création, en
1966, par le ministre tunisien de la Culture, du festival panafricain des
« Journées Cinématographiques de Carthage » (qui acclama le premier
long-métrage d'Ousmane Sembène La Noire de... / Black Girl), bientôt
suivi en 1969 par le « Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou »
(Burkina Faso). L'année suivante voit la création de la Fédération Panafri-
caine des Cinéastes (FEPACI) qui réunit trente-trois pays du continent et
dont le credo, comme celui des deux festivals, est d'être une voix d'incitation
auprès des gouvernements africains afin qu'ils prennent les mesures pro-
tectionnistes nécessaires à la survie de leur cinéma naissant, un cinéma qui
confirme ses promesses avec des premiers essais à la hauteur des œuvres
des maîtres.