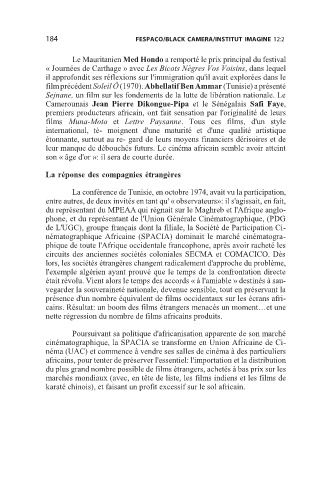Page 193 - Livre2_NC
P. 193
184 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
Le Mauritanien Med Hondo a remporté le prix principal du festival
« Journées de Carthage » avec Les Bicots Nègres Vos Voisins, dans lequel
il approfondit ses réflexions sur l'immigration qu'il avait explorées dans le
film précédent Soleil Ô (1970). Abhellatif Ben Ammar (Tunisie) a présenté
Sejnane, un film sur les fondements de la lutte de libération nationale. Le
Camerounais Jean Pierre Dikongue-Pipa et le Sénégalais Safi Faye,
premiers producteurs africain, ont fait sensation par l'originalité de leurs
films Muna-Moto et Lettre Paysanne. Tous ces films, d'un style
international, té- moignent d'une maturité et d'une qualité artistique
étonnante, surtout au re- gard de leurs moyens financiers dérisoires et de
leur manque de débouchés futurs. Le cinéma africain semble avoir atteint
son « âge d'or »: il sera de courte durée.
La réponse des compagnies étrangères
La conférence de Tunisie, en octobre 1974, avait vu la participation,
entre autres, de deux invités en tant qu' « observateurs»: il s'agissait, en fait,
du représentant du MPEAA qui régnait sur le Maghreb et l'Afrique anglo-
phone, et du représentant de l'Union Générale Cinématographique, (PDG
de L'UGC), groupe français dont la filiale, la Société de Participation Ci-
nématographique Africaine (SPACIA) dominait le marché cinématogra-
phique de toute l'Afrique occidentale francophone, après avoir racheté les
circuits des anciennes sociétés coloniales SECMA et COMACICO. Dès
lors, les sociétés étrangères changent radicalement d'approche du problème,
l'exemple algérien ayant prouvé que le temps de la confrontation directe
était révolu. Vient alors le temps des accords « à l'amiable » destinés à sau-
vegarder la souveraineté nationale, devenue sensible, tout en préservant la
présence d'un nombre équivalent de films occidentaux sur les écrans afri-
cains. Résultat: un boom des films étrangers menacés un moment…et une
nette régression du nombre de films africains produits.
Poursuivant sa politique d'africanisation apparente de son marché
cinématographique, la SPACIA se transforme en Union Africaine de Ci-
néma (UAC) et commence à vendre ses salles de cinéma à des particuliers
africains, pour tenter de préserver l'essentiel: l'importation et la distribution
du plus grand nombre possible de films étrangers, achetés à bas prix sur les
marchés mondiaux (avec, en tête de liste, les films indiens et les films de
karaté chinois), et faisant un profit excessif sur le sol africain.